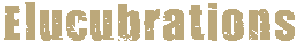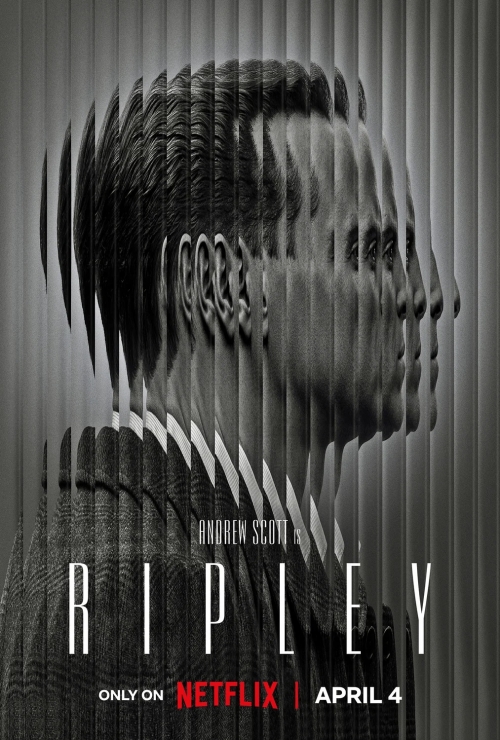Loading...
21
Jan 2018Le dernier jour de Louis XVI
Posté dans Bureau des Archives - Source: http://www.lhistoire.fr/...
Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté sur la place de la Révolution, à Paris. Réglée dans les moindres détails, cette mise à mort apparaît comme le sacrifice rituel et sanglant qui a fondé la République française.
Lorsque la France est entrée en république, au cours de l'été 1792, elle n'a pas solennellement proclamé la fondation d'un nouveau régime. L'historien peut chercher : il ne dénichera nulle part dans les archives un décret officiel. Tout juste trouvera-t-il, le 21 septembre 1792, une proposition de Camus, responsable des Archives nationales, de dater désormais les documents administratifs de l' « an I de la République française » . En revanche, entre le 10 août et le 21 septembre 1792, les députés de l'Assemblée nationale n'ont cessé de proclamer à la face du monde la « suspension » puis l' « abolition » de la royauté en France. Ils savaient ce qu'ils voulaient détruire, pas encore ce qu'il fallait construire. Ce désir de clore le régime monarchique trouve son aboutissement logique dans l'exécution de Louis XVI, le lundi 21 janvier 1793. Cette cérémonie fait office de rite fondateur pour la jeune république, et remplace en quelque sorte la proclamation officielle du régime. Mais c'est aussi un rite de sang qui doit frapper les esprits et qui, tout en faisant la fierté du républicain français, met la France au ban des nations européennes, monarchiques et traditionnelles.
Dans la matinée du 10 août 1792, Louis XVI fuit le palais des Tuileries assiégé par la foule pour se réfugier à l'Assemblée nationale. A l'annonce de l'arrivée du roi et de sa famille, la Législative demeure circonspecte. La Constitution autorise certes le souverain à se rendre quand il le veut au milieu des représentants du peuple.
Louis Capet à la barre
Mais les députés, devenus majoritairement hostiles à l'autorité royale, ne désirent aucunement paraître prendre parti pour lui. Aussi, sous l'autorité de Vergniaud, président de l'Assemblée, est-il décidé de s'en tenir strictement au rituel fixé par la Législative en pareil cas : une députation minimale de 24 membres se rend à la rencontre du roi dans l'antichambre de la salle légiférante, un fauteuil est accolé en hâte à celui du président, et le monarque se voit accueilli sans trouble ni émotion. En quelque sorte, par la dédramatisation de cette cérémonie d'accueil, l'Assemblée marque son désir de demeurer neutre : il s'agit d'une affaire entre le roi et le peuple, et les députés se contentent d'observer.
Louis XVI comprend le risque de cette neutralité ; il tente donc, en s'adressant aux députés, de dramatiser la scène : « Messieurs, je suis venu ici pour éviter une grande crise et je pense que je ne saurais être plus en sûreté qu'au milieu de vous. » Mais l'Assemblée refuse ce rôle de « sauveur de la monarchie » que le roi aux abois lui propose : elle offre le souverain en sacrifice au peuple qui, à quelques pas de là, devant le château des Tuileries, demande sa tête. Cette dérobade est parfaitement illustrée par une clause du règlement cérémoniel interne à l'Assemblée : le roi, une fois son discours prononcé, et devant qui les députés ne peuvent légalement délibérer, quitte son fauteuil et est placé avec sa famille dans une loge située derrière le président, hors de l'« enceinte sacrée » du pouvoir politique.
La monarchie est ainsi véritablement escamotée par une Assemblée qui s'en remet à la décision de la rue. Et si personne n'a pensé à interrompre la lutte sanglante qui y oppose le peuple aux éléments armés restés fidèles au roi, et qui fera près de 4 000 victimes, c'est que chacun en attend l'issue comme une sorte d'ordalie politique. Le roi a été extrait de la nation, et il est tenu en réserve jusqu'à la victoire définitive du peuple. Ainsi, tout en appartenant à la chronologie monarchique, cette séance parlementaire du 10 août 1792 est déjà un rituel de république.
Quelques heures plus tard, une fois les royalistes éliminés de la rue, les députés décident de « suspendre » la monarchie et de convoquer une nouvelle Assemblée nationale, afin de poser les bases d'un autre régime « propre au tempérament des Français régénérés » . D'une certaine manière, la loge attribuée à Louis XVI au cours de cette séance décisive figurait cette « suspension ». En revanche, la prison que la Commune* insurrectionnelle de Paris - le pouvoir qui s'affirme lorsque l'Assemblée nationale s'autodissout - affecte au monarque déchu s'inscrit clairement dans un rituel d'humiliation. Louis doit en effet désormais résider, sous haute surveillance, au Temple, dans la tourelle, ce donjon froid et obscur où les moindres gestes de la famille royale sont consignés par les gardiens municipaux.
L'aboutissement de cette humiliation advient le 3 décembre 1792, lorsque les députés de la nouvelle Assemblée nationale, réunis à Paris depuis plus de deux mois, décident que « Louis Capet et ses défenseurs seront entendus à la barre de la Convention nationale » . Le procès du roi constitue le dernier épisode de cette lutte de protocole qui a longtemps opposé l'Assemblée nationale, représentant le peuple français, et Louis XVI, figure de la tradition monarchique - un épisode cruel : la sévérité républicaine triomphe de la majesté royale.
Le procès débute le 11 décembre 1792 devant la Convention*. Le roi est debout à la barre lorsque le président de la Convention, Barère, s'adresse à lui : « Louis, la nation française vous accuse. Vous allez entendre la lecture de l'acte énonciatif des faits. Louis, asseyez-vous. » C'est alors, au moment où le roi s'assoit sur une « humble chaise » sous les yeux de députés déjà assis et couverts, que le rituel de sa disparition se met en place. Cette disparition est l'exacte réponse à la théorie monarchique de l'inviolabilité sacrée du corps du roi.
La théorie des Montagnards*, prônant l'exécution immédiate de Louis XVI, va pour sa part prendre appui sur cette même exception de la personne du roi, qu'elle transforme alors en une monstruosité. Puisque Louis est un « corps hors la nation » , la république ne peut s'instaurer qu'en l'anéantissant : il existe une incompatibilité entre le roi et le peuple, le principe d'exception et le principe d'égalité. Le 3 décembre, Robespierre avance l'argument avec une imparable logique : « Louis fut roi, et la république est fondée . [...] La victoire et le peuple ont décidé que lui seul était rebelle : Louis ne peut donc être jugé ; il est déjà condamné, ou la république n'est point absoute. Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. »
Les Montagnards appellent donc la Convention à organiser un sacrifice fondateur : Louis doit mourir pour que s'établisse l'égalité entre les citoyens, principe premier de la république nouvelle, du peuple régénéré. Cette logique, après un mois et demi de débats houleux et serrés, emporte finalement la décision de la Convention. Le vote ultime, public et par appel nominal, débute dans l'après-midi du 15 janvier 1793. Trente-six heures plus tard, le député du Gard Voulland apporte à la cause de la mort immédiate sa 361e voix, décisive, celle de la majorité absolue.
En sacrifiant ainsi Louis XVI, la république immole le sacré dont le corps du roi était encore investi. Ce supplice ne peut pas être mieux figuré, aux yeux de tous les citoyens, qu'à travers la rencontre entre le roi et la guillotine*, la nouvelle machine de l'égalité républicaine. C'est une négation irréfutable de l'exception royale : la « simple mécanique » peut trancher sa tête.
Si la mise en scène de l'événement se doit donc de revêtir une solennité particulière, la mort elle-même et son instrument sont ordinaires. La guillotine qui tranche la tête de Louis XVI est exactement la même que celle qui a déjà servi depuis août 1792, et servira plus encore après. L'échafaud a simplement été transféré vers la place de la Révolution, entre le piédestal de l'ancienne statue de Louis XV et le commencement des Champs-Élysées, pour offrir à la cérémonie toute la place et la solennité qu'elle requiert.
Le dimanche 20 janvier, une délégation du conseil exécutif de la Commune de Paris vient lire à Louis XVI la sentence, qu'il connaît déjà par ses défenseurs, et lui faire connaître les « dispositions cérémonielles » du supplice. Le roi, qui ne se départira plus désormais d'un calme imposant, reçoit ces dispositions avec une apparente tranquillité d'esprit, mais fait trois demandes. Un « délai de trois jours pour pouvoir me préparer à paraître en présence de Dieu » , la liberté pour sa famille - deux souhaits qui lui seront immédiatement refusés par la Convention -, et la possibilité de se confesser en toute confiance et liberté auprès du prêtre de son choix, seul à seul.
Louis XVI a choisi l'abbé Edgeworth de Firmont, d'origine irlandaise, prêtre non assermenté, et ouvertement contre-révolutionnaire*. La république lui fait cette concession - permettant ainsi paradoxalement au roi de composer, grâce à la religion traditionnelle, un contre-rituel, une sorte de cérémonie concurrente de la cérémonie républicaine : l'abbé de Firmont, arrivé à la prison du Temple à 7 heures du soir le 20 janvier, ne quittera plus le roi jusqu'à son exécution.
A 8 heures ce même soir, Louis XVI fait ses adieux à sa famille : sa femme, la reine Marie-Antoinette, sa soeur, Mme Élisabeth, le Dauphin, et sa fille, Mme Royale. La scène est surveillée par les gardiens, à travers une cloison vitrée, sans qu'il soit possible d'entendre la moindre parole. Le récit le plus fidèle semble avoir été écrit par Cléry, le valet de chambre du roi, républicain, imposé à la prison du Temple par la Municipalité de Paris, mais conquis par le flegme et la confiance de Louis XVI : « Il fut impossible de rien entendre ; on voyait seulement qu'après chaque phrase du roi, les sanglots des princesses redoublaient et qu'ensuite le roi recommençait à parler. Il fut aisé de juger à leurs mouvements que lui-même leur avait appris sa condamnation1. »
Cette rencontre dure deux heures, et Louis y met fin en promettant l'adieu définitif pour le lendemain matin. Cette promesse est une ruse destinée à abréger les déchirements familiaux : l'entrevue du 20 janvier au soir est bien l'ultime scène familiale du règne. Mais c'est aussi le moment privilégié où commence le récit du martyre dans la tradition monarchique. Car si la république construit un rituel de fondation à travers cette mise à mort, la royauté tente de son côté de proposer une autre version des faits : un Très-Chrétien, un innocent, monte à l'échafaud, autant qu'un bon père de famille et un roi de France ; c'est un saint que la république met à mort.
Le seul lien entre ces deux lectures de l'événement, c'est Henri Sanson, le bourreau, homme d'Ancien Régime - que certains présentent d'ailleurs comme un fervent royaliste -, oeuvrant autrefois sur la roue ou la potence, officiant désormais auprès de la guillotine, assisté de son fils, Henri-François, et d'un premier aide, Legros. Tous ces bourreaux se préparent au supplice suivant les formes rituelles anciennes - Sanson, le 20 janvier, s'est fait donner l'absolution par un prêtre, l'abbé de Keravenant - mais aussi nouvelles - les gonds, les portants coulissants, les montants de la guillotine ont été vérifiés, et la lame elle-même a été aiguisée.
En cette veille d'exécution, c'est toutefois la Municipalité parisienne qui se prépare le plus activement. Trancher la tête du roi : voilà qui inquiète certains esprits. Comment le peuple va-t-il réagir à cet acte inédit dans l'histoire françaiseet#8194;? Peut-on laisser Louis XVI prononcer une ultime harangue ? Même si personne ne croit à une intervention divine - lame arrêtée net dans sa fulgurante descente ou recollation miraculeuse de la tête de « Saint Louis » -, beaucoup redoutent un ultime coup de force royaliste qui tenterait de sauver le roi le long du parcours - la réaction ne s'est d'ailleurs pas fait attendre et le député régicide Lepeletier de Saint-Fargeau a été assassiné par un ancien garde du roi, le 20 janvier à 6 heures du soir, chez Février, un restaurant du Palais-Royal...
Aussi la Commune de Paris et certaines sections situées sur le trajet menant de la prison du Temple à l'échafaud préparent-elles le dispositif dans ses moindres détails. D'une part, les personnes soupçonnées d'être trop favorables au roi, ou même d'être sensibles et compatissantes à son destin, sont maintenues à l'écart. Les royalistes bien sûr, mais également les femmes, aux humeurs prétendument plus accessibles à la pitié : « Tout homme qui criera grâce ou qui s'agitera sans considération sera arrêté et conduit en prison. Les femmes ne sortiront pas de chez elles. Les sections seront en armes à leurs différents postes » , propose la section des Gravilliers en un arrêté immédiatement repris par les sections voisines. D'autre part, la gestion du rituel est exclusivement confiée à la force armée. Louis XVI, dans ses derniers regards, ne croisera que des hommes en armes : aussi bien le long du trajet, où 12 000 hommes des sections de Paris prennent place très tôt dans la nuit du 20 au 21 janvier, que sur la place de la Révolution, où près de 80 000 hommes, gardes nationaux et gendarmes, sont déployés, protégés par 84 pièces d'artillerie.
« Depuis 5 heures, on entendait le roulement sourd des canons et des caissons, le trot de la cavalerie, le pas régulier de la troupe ; c'est un événement qui se préparait » , écrit un étudiant de Paris au petit matin du 21 janvier 17932. Cinq heures, c'est en effet l'heure à laquelle Louis XVI a demandé à Cléry, son valet, de le réveiller ; de même que, de son côté, Sanson l'a demandé à son assistant. Cléry coiffe le roi, longuement. Le jeûne accompagne ce dernier rite du « paraître en présence de Dieu », de même que l'ultime confession, de 6 heures à 7 heures, seul à seul, dans le cabinet de la tourelle du Temple, avec l'abbé de Firmont.
Pendant ce temps, Cléry dispose dans la chambre du roi, aménagée en autel, les objets bénits réquisitionnés la veille par la municipalité en l'église des Capucins du Marais pour la dernière eucharistie avant le supplice, ce supplice que les royalistes compareront bientôt eux-mêmes au sacrifice du Christ offrant son sang pour sauver les hommes. En secret, Louis confie à Cléry quelques objets qui deviendront des reliques3.
Puis, Louis XVI s'habille avec l'aide de son valet : une chemise fraîche, le gilet blanc cassé porté la veille, une culotte grise, un habit clair. Un premier incident survient cependant : les gardiens opposent un ferme refus lorsque le roi cherche à étendre le rituel monarchique aux actes d'humiliation républicains qui puniront son corps. Cléry, ainsi, n'est pas autorisé à lui couper les cheveux, ni même à l'accompagner pour le déshabiller au bas de l'échafaud. De cela, les bourreaux se chargeront.
Enfin, un quart d'heure avant 8 heures, arrive la délégation municipale, conduite par Santerre, commandant de la garde nationale* de Paris, accompagné de dix soldats placés au garde-à-vous sur deux rangs, dans l'antichambre de la prison du Temple. Louis XVI prend un dernier instant pour s'agenouiller, dans son cabinet privé, aux pieds de l'abbé de Firmont qui lui donne la bénédiction.
Une faveur a été accordée au roi : c'est en voiture - dans le carrosse du maire de Paris - qu'il va au supplice, non dans la charrette des condamnés à mort. Deux gendarmes l'y accompagnent, ainsi que l'abbé de Firmont, assis sur la banquette de devant. Louis XVI murmure la prière des agonisants, et rien, sur le trajet, ne vient rompre cette litanie. La foule, contenue derrière les soldats, est muette, comme prévu. Le trajet, dans des rues encore à demi obstruées par des plaques de neige, prend plus de deux heures, au pas lent des chevaux des 100 cavaliers de la gendarmerie qui précèdent le carrosse, comme des 100 cavaliers de la garde nationale qui le suivent.
« Peuple, je meurs innocent... »
Le carrosse parvient un peu après 10 heures sur la place de la Révolution. Il y stationne cinq minutes dans le silence, sans qu'aucun geste ne soit visible à l'intérieur de la voiture. Legros, l'assistant de Sanson, et un officier municipal ouvrent enfin la porte. Le roi descend, et d'un geste vif rappelle une dernière fois le cours du rituel royal que la république ne veut pas considérer : il refuse qu'on le touche. L'inviolabilité de son corps est incompatible avec le déshabillage public et les liens que l'on veut lui imposer. Le conflit cérémoniel s'achève par un échange de regards entre le roi et son confesseur : ce dernier fait comprendre au monarque que le sacrifice du corps royal doit être complet. Louis XVI obtempère, se dévêt de son habit, ouvre le col de sa chemise et, pour dégager le cou, la rabat sur ses épaules. Il se laisse « garrotter », puis, les mains derrière le dos, couper les cheveux, qu'il porte court sous la perruque.
Appuyé sur son confesseur, il gravit les marches raides menant à l'échafaud. Lorsque les trois bourreaux le saisissent et l'attachent à la planche, il crie, d'une voix forte : « Peuple, je meurs innocent des crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France... » Les roulements des tambours couvrent alors sa voix, tandis qu' « il a un moment levé les yeux avant qu'on ne le couche sous le glaive qui a tranché ses jours » 4. Il est 10 h 22.
« Le peuple était resté morne pendant tout ce temps. Au moment que le ciseau fatal fut tombé, des cris de «Vive la liberté ! Vive la nation !» se sont fait entendre, et tous les bonnets et chapeaux furent mis au bout des piques et des baïonnettes lorsque le bourreau fit son office en montrant la tête5. » Les soldats des premiers rangs trempent même leur sabre ou leur baïonnette dans le sang répandu, tandis que les cheveux du roi, ainsi que son habit, coupé en morceaux et rougi de sang, sont rapidement proposés aux enchères par les officiers municipaux.
Le cadavre du roi est immédiatement transporté à l'ancienne église de la Madeleine. La Convention a en effet refusé que les restes de Louis XVI soient inhumés à Sens, auprès de son père. Elle avait accordé une faveur exceptionnelle au roi en le laissant mourir dans la religion de ses pères, entouré du rituel religieux. Dès lors que la guillotine a rencontré le corps du roi, le cadavre appartient à la république : ce sont deux vicaires assermentés, fidèles au nouveau régime, qui officient pour le court service funéraire célébré à la Madeleine.
Le vicaire Damoureau témoigne : « Le corps, mis à découvert dans la bière, fut, d'après les ordres du pouvoir exécutif, jeté au fond de la fosse, sur un lit de chaux vive. La tête fut placée à ses pieds. Le tout fut ensuite couvert d'un lit de chaux vive, puis d'un lit de terre, le tout fortement battu, et à plusieurs reprises. » Il s'agit de corrompre ce corps le plus rapidement possible, afin de dérober les restes à toute vénération et à toute tentative d'enlèvement.
Ce n'est que le 19 janvier 1815, en présence de Mme Royale devenue duchesse d'Angoulême, que l'on déterra officiellement ces restes, qui furent déposés solennellement, le 21 janvier 1815, dans la crypte restaurée de la basilique de Saint-Denis, où était gravée sur une plaque vermeil l'inscription de la tradition : « Ici est le corps du très haut, très puissant et très excellent prince Louis XVIe du nom par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. »
Lorsque la France est entrée en république, au cours de l'été 1792, elle n'a pas solennellement proclamé la fondation d'un nouveau régime. L'historien peut chercher : il ne dénichera nulle part dans les archives un décret officiel. Tout juste trouvera-t-il, le 21 septembre 1792, une proposition de Camus, responsable des Archives nationales, de dater désormais les documents administratifs de l' « an I de la République française » . En revanche, entre le 10 août et le 21 septembre 1792, les députés de l'Assemblée nationale n'ont cessé de proclamer à la face du monde la « suspension » puis l' « abolition » de la royauté en France. Ils savaient ce qu'ils voulaient détruire, pas encore ce qu'il fallait construire. Ce désir de clore le régime monarchique trouve son aboutissement logique dans l'exécution de Louis XVI, le lundi 21 janvier 1793. Cette cérémonie fait office de rite fondateur pour la jeune république, et remplace en quelque sorte la proclamation officielle du régime. Mais c'est aussi un rite de sang qui doit frapper les esprits et qui, tout en faisant la fierté du républicain français, met la France au ban des nations européennes, monarchiques et traditionnelles.
Dans la matinée du 10 août 1792, Louis XVI fuit le palais des Tuileries assiégé par la foule pour se réfugier à l'Assemblée nationale. A l'annonce de l'arrivée du roi et de sa famille, la Législative demeure circonspecte. La Constitution autorise certes le souverain à se rendre quand il le veut au milieu des représentants du peuple.
Louis Capet à la barre
Mais les députés, devenus majoritairement hostiles à l'autorité royale, ne désirent aucunement paraître prendre parti pour lui. Aussi, sous l'autorité de Vergniaud, président de l'Assemblée, est-il décidé de s'en tenir strictement au rituel fixé par la Législative en pareil cas : une députation minimale de 24 membres se rend à la rencontre du roi dans l'antichambre de la salle légiférante, un fauteuil est accolé en hâte à celui du président, et le monarque se voit accueilli sans trouble ni émotion. En quelque sorte, par la dédramatisation de cette cérémonie d'accueil, l'Assemblée marque son désir de demeurer neutre : il s'agit d'une affaire entre le roi et le peuple, et les députés se contentent d'observer.
Louis XVI comprend le risque de cette neutralité ; il tente donc, en s'adressant aux députés, de dramatiser la scène : « Messieurs, je suis venu ici pour éviter une grande crise et je pense que je ne saurais être plus en sûreté qu'au milieu de vous. » Mais l'Assemblée refuse ce rôle de « sauveur de la monarchie » que le roi aux abois lui propose : elle offre le souverain en sacrifice au peuple qui, à quelques pas de là, devant le château des Tuileries, demande sa tête. Cette dérobade est parfaitement illustrée par une clause du règlement cérémoniel interne à l'Assemblée : le roi, une fois son discours prononcé, et devant qui les députés ne peuvent légalement délibérer, quitte son fauteuil et est placé avec sa famille dans une loge située derrière le président, hors de l'« enceinte sacrée » du pouvoir politique.
La monarchie est ainsi véritablement escamotée par une Assemblée qui s'en remet à la décision de la rue. Et si personne n'a pensé à interrompre la lutte sanglante qui y oppose le peuple aux éléments armés restés fidèles au roi, et qui fera près de 4 000 victimes, c'est que chacun en attend l'issue comme une sorte d'ordalie politique. Le roi a été extrait de la nation, et il est tenu en réserve jusqu'à la victoire définitive du peuple. Ainsi, tout en appartenant à la chronologie monarchique, cette séance parlementaire du 10 août 1792 est déjà un rituel de république.
Quelques heures plus tard, une fois les royalistes éliminés de la rue, les députés décident de « suspendre » la monarchie et de convoquer une nouvelle Assemblée nationale, afin de poser les bases d'un autre régime « propre au tempérament des Français régénérés » . D'une certaine manière, la loge attribuée à Louis XVI au cours de cette séance décisive figurait cette « suspension ». En revanche, la prison que la Commune* insurrectionnelle de Paris - le pouvoir qui s'affirme lorsque l'Assemblée nationale s'autodissout - affecte au monarque déchu s'inscrit clairement dans un rituel d'humiliation. Louis doit en effet désormais résider, sous haute surveillance, au Temple, dans la tourelle, ce donjon froid et obscur où les moindres gestes de la famille royale sont consignés par les gardiens municipaux.
L'aboutissement de cette humiliation advient le 3 décembre 1792, lorsque les députés de la nouvelle Assemblée nationale, réunis à Paris depuis plus de deux mois, décident que « Louis Capet et ses défenseurs seront entendus à la barre de la Convention nationale » . Le procès du roi constitue le dernier épisode de cette lutte de protocole qui a longtemps opposé l'Assemblée nationale, représentant le peuple français, et Louis XVI, figure de la tradition monarchique - un épisode cruel : la sévérité républicaine triomphe de la majesté royale.
Le procès débute le 11 décembre 1792 devant la Convention*. Le roi est debout à la barre lorsque le président de la Convention, Barère, s'adresse à lui : « Louis, la nation française vous accuse. Vous allez entendre la lecture de l'acte énonciatif des faits. Louis, asseyez-vous. » C'est alors, au moment où le roi s'assoit sur une « humble chaise » sous les yeux de députés déjà assis et couverts, que le rituel de sa disparition se met en place. Cette disparition est l'exacte réponse à la théorie monarchique de l'inviolabilité sacrée du corps du roi.
La théorie des Montagnards*, prônant l'exécution immédiate de Louis XVI, va pour sa part prendre appui sur cette même exception de la personne du roi, qu'elle transforme alors en une monstruosité. Puisque Louis est un « corps hors la nation » , la république ne peut s'instaurer qu'en l'anéantissant : il existe une incompatibilité entre le roi et le peuple, le principe d'exception et le principe d'égalité. Le 3 décembre, Robespierre avance l'argument avec une imparable logique : « Louis fut roi, et la république est fondée . [...] La victoire et le peuple ont décidé que lui seul était rebelle : Louis ne peut donc être jugé ; il est déjà condamné, ou la république n'est point absoute. Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. »
Les Montagnards appellent donc la Convention à organiser un sacrifice fondateur : Louis doit mourir pour que s'établisse l'égalité entre les citoyens, principe premier de la république nouvelle, du peuple régénéré. Cette logique, après un mois et demi de débats houleux et serrés, emporte finalement la décision de la Convention. Le vote ultime, public et par appel nominal, débute dans l'après-midi du 15 janvier 1793. Trente-six heures plus tard, le député du Gard Voulland apporte à la cause de la mort immédiate sa 361e voix, décisive, celle de la majorité absolue.
En sacrifiant ainsi Louis XVI, la république immole le sacré dont le corps du roi était encore investi. Ce supplice ne peut pas être mieux figuré, aux yeux de tous les citoyens, qu'à travers la rencontre entre le roi et la guillotine*, la nouvelle machine de l'égalité républicaine. C'est une négation irréfutable de l'exception royale : la « simple mécanique » peut trancher sa tête.
Si la mise en scène de l'événement se doit donc de revêtir une solennité particulière, la mort elle-même et son instrument sont ordinaires. La guillotine qui tranche la tête de Louis XVI est exactement la même que celle qui a déjà servi depuis août 1792, et servira plus encore après. L'échafaud a simplement été transféré vers la place de la Révolution, entre le piédestal de l'ancienne statue de Louis XV et le commencement des Champs-Élysées, pour offrir à la cérémonie toute la place et la solennité qu'elle requiert.
Le dimanche 20 janvier, une délégation du conseil exécutif de la Commune de Paris vient lire à Louis XVI la sentence, qu'il connaît déjà par ses défenseurs, et lui faire connaître les « dispositions cérémonielles » du supplice. Le roi, qui ne se départira plus désormais d'un calme imposant, reçoit ces dispositions avec une apparente tranquillité d'esprit, mais fait trois demandes. Un « délai de trois jours pour pouvoir me préparer à paraître en présence de Dieu » , la liberté pour sa famille - deux souhaits qui lui seront immédiatement refusés par la Convention -, et la possibilité de se confesser en toute confiance et liberté auprès du prêtre de son choix, seul à seul.
Louis XVI a choisi l'abbé Edgeworth de Firmont, d'origine irlandaise, prêtre non assermenté, et ouvertement contre-révolutionnaire*. La république lui fait cette concession - permettant ainsi paradoxalement au roi de composer, grâce à la religion traditionnelle, un contre-rituel, une sorte de cérémonie concurrente de la cérémonie républicaine : l'abbé de Firmont, arrivé à la prison du Temple à 7 heures du soir le 20 janvier, ne quittera plus le roi jusqu'à son exécution.
A 8 heures ce même soir, Louis XVI fait ses adieux à sa famille : sa femme, la reine Marie-Antoinette, sa soeur, Mme Élisabeth, le Dauphin, et sa fille, Mme Royale. La scène est surveillée par les gardiens, à travers une cloison vitrée, sans qu'il soit possible d'entendre la moindre parole. Le récit le plus fidèle semble avoir été écrit par Cléry, le valet de chambre du roi, républicain, imposé à la prison du Temple par la Municipalité de Paris, mais conquis par le flegme et la confiance de Louis XVI : « Il fut impossible de rien entendre ; on voyait seulement qu'après chaque phrase du roi, les sanglots des princesses redoublaient et qu'ensuite le roi recommençait à parler. Il fut aisé de juger à leurs mouvements que lui-même leur avait appris sa condamnation1. »
Cette rencontre dure deux heures, et Louis y met fin en promettant l'adieu définitif pour le lendemain matin. Cette promesse est une ruse destinée à abréger les déchirements familiaux : l'entrevue du 20 janvier au soir est bien l'ultime scène familiale du règne. Mais c'est aussi le moment privilégié où commence le récit du martyre dans la tradition monarchique. Car si la république construit un rituel de fondation à travers cette mise à mort, la royauté tente de son côté de proposer une autre version des faits : un Très-Chrétien, un innocent, monte à l'échafaud, autant qu'un bon père de famille et un roi de France ; c'est un saint que la république met à mort.
Le seul lien entre ces deux lectures de l'événement, c'est Henri Sanson, le bourreau, homme d'Ancien Régime - que certains présentent d'ailleurs comme un fervent royaliste -, oeuvrant autrefois sur la roue ou la potence, officiant désormais auprès de la guillotine, assisté de son fils, Henri-François, et d'un premier aide, Legros. Tous ces bourreaux se préparent au supplice suivant les formes rituelles anciennes - Sanson, le 20 janvier, s'est fait donner l'absolution par un prêtre, l'abbé de Keravenant - mais aussi nouvelles - les gonds, les portants coulissants, les montants de la guillotine ont été vérifiés, et la lame elle-même a été aiguisée.
En cette veille d'exécution, c'est toutefois la Municipalité parisienne qui se prépare le plus activement. Trancher la tête du roi : voilà qui inquiète certains esprits. Comment le peuple va-t-il réagir à cet acte inédit dans l'histoire françaiseet#8194;? Peut-on laisser Louis XVI prononcer une ultime harangue ? Même si personne ne croit à une intervention divine - lame arrêtée net dans sa fulgurante descente ou recollation miraculeuse de la tête de « Saint Louis » -, beaucoup redoutent un ultime coup de force royaliste qui tenterait de sauver le roi le long du parcours - la réaction ne s'est d'ailleurs pas fait attendre et le député régicide Lepeletier de Saint-Fargeau a été assassiné par un ancien garde du roi, le 20 janvier à 6 heures du soir, chez Février, un restaurant du Palais-Royal...
Aussi la Commune de Paris et certaines sections situées sur le trajet menant de la prison du Temple à l'échafaud préparent-elles le dispositif dans ses moindres détails. D'une part, les personnes soupçonnées d'être trop favorables au roi, ou même d'être sensibles et compatissantes à son destin, sont maintenues à l'écart. Les royalistes bien sûr, mais également les femmes, aux humeurs prétendument plus accessibles à la pitié : « Tout homme qui criera grâce ou qui s'agitera sans considération sera arrêté et conduit en prison. Les femmes ne sortiront pas de chez elles. Les sections seront en armes à leurs différents postes » , propose la section des Gravilliers en un arrêté immédiatement repris par les sections voisines. D'autre part, la gestion du rituel est exclusivement confiée à la force armée. Louis XVI, dans ses derniers regards, ne croisera que des hommes en armes : aussi bien le long du trajet, où 12 000 hommes des sections de Paris prennent place très tôt dans la nuit du 20 au 21 janvier, que sur la place de la Révolution, où près de 80 000 hommes, gardes nationaux et gendarmes, sont déployés, protégés par 84 pièces d'artillerie.
« Depuis 5 heures, on entendait le roulement sourd des canons et des caissons, le trot de la cavalerie, le pas régulier de la troupe ; c'est un événement qui se préparait » , écrit un étudiant de Paris au petit matin du 21 janvier 17932. Cinq heures, c'est en effet l'heure à laquelle Louis XVI a demandé à Cléry, son valet, de le réveiller ; de même que, de son côté, Sanson l'a demandé à son assistant. Cléry coiffe le roi, longuement. Le jeûne accompagne ce dernier rite du « paraître en présence de Dieu », de même que l'ultime confession, de 6 heures à 7 heures, seul à seul, dans le cabinet de la tourelle du Temple, avec l'abbé de Firmont.
Pendant ce temps, Cléry dispose dans la chambre du roi, aménagée en autel, les objets bénits réquisitionnés la veille par la municipalité en l'église des Capucins du Marais pour la dernière eucharistie avant le supplice, ce supplice que les royalistes compareront bientôt eux-mêmes au sacrifice du Christ offrant son sang pour sauver les hommes. En secret, Louis confie à Cléry quelques objets qui deviendront des reliques3.
Puis, Louis XVI s'habille avec l'aide de son valet : une chemise fraîche, le gilet blanc cassé porté la veille, une culotte grise, un habit clair. Un premier incident survient cependant : les gardiens opposent un ferme refus lorsque le roi cherche à étendre le rituel monarchique aux actes d'humiliation républicains qui puniront son corps. Cléry, ainsi, n'est pas autorisé à lui couper les cheveux, ni même à l'accompagner pour le déshabiller au bas de l'échafaud. De cela, les bourreaux se chargeront.
Enfin, un quart d'heure avant 8 heures, arrive la délégation municipale, conduite par Santerre, commandant de la garde nationale* de Paris, accompagné de dix soldats placés au garde-à-vous sur deux rangs, dans l'antichambre de la prison du Temple. Louis XVI prend un dernier instant pour s'agenouiller, dans son cabinet privé, aux pieds de l'abbé de Firmont qui lui donne la bénédiction.
Une faveur a été accordée au roi : c'est en voiture - dans le carrosse du maire de Paris - qu'il va au supplice, non dans la charrette des condamnés à mort. Deux gendarmes l'y accompagnent, ainsi que l'abbé de Firmont, assis sur la banquette de devant. Louis XVI murmure la prière des agonisants, et rien, sur le trajet, ne vient rompre cette litanie. La foule, contenue derrière les soldats, est muette, comme prévu. Le trajet, dans des rues encore à demi obstruées par des plaques de neige, prend plus de deux heures, au pas lent des chevaux des 100 cavaliers de la gendarmerie qui précèdent le carrosse, comme des 100 cavaliers de la garde nationale qui le suivent.
« Peuple, je meurs innocent... »
Le carrosse parvient un peu après 10 heures sur la place de la Révolution. Il y stationne cinq minutes dans le silence, sans qu'aucun geste ne soit visible à l'intérieur de la voiture. Legros, l'assistant de Sanson, et un officier municipal ouvrent enfin la porte. Le roi descend, et d'un geste vif rappelle une dernière fois le cours du rituel royal que la république ne veut pas considérer : il refuse qu'on le touche. L'inviolabilité de son corps est incompatible avec le déshabillage public et les liens que l'on veut lui imposer. Le conflit cérémoniel s'achève par un échange de regards entre le roi et son confesseur : ce dernier fait comprendre au monarque que le sacrifice du corps royal doit être complet. Louis XVI obtempère, se dévêt de son habit, ouvre le col de sa chemise et, pour dégager le cou, la rabat sur ses épaules. Il se laisse « garrotter », puis, les mains derrière le dos, couper les cheveux, qu'il porte court sous la perruque.
Appuyé sur son confesseur, il gravit les marches raides menant à l'échafaud. Lorsque les trois bourreaux le saisissent et l'attachent à la planche, il crie, d'une voix forte : « Peuple, je meurs innocent des crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France... » Les roulements des tambours couvrent alors sa voix, tandis qu' « il a un moment levé les yeux avant qu'on ne le couche sous le glaive qui a tranché ses jours » 4. Il est 10 h 22.
« Le peuple était resté morne pendant tout ce temps. Au moment que le ciseau fatal fut tombé, des cris de «Vive la liberté ! Vive la nation !» se sont fait entendre, et tous les bonnets et chapeaux furent mis au bout des piques et des baïonnettes lorsque le bourreau fit son office en montrant la tête5. » Les soldats des premiers rangs trempent même leur sabre ou leur baïonnette dans le sang répandu, tandis que les cheveux du roi, ainsi que son habit, coupé en morceaux et rougi de sang, sont rapidement proposés aux enchères par les officiers municipaux.
Le cadavre du roi est immédiatement transporté à l'ancienne église de la Madeleine. La Convention a en effet refusé que les restes de Louis XVI soient inhumés à Sens, auprès de son père. Elle avait accordé une faveur exceptionnelle au roi en le laissant mourir dans la religion de ses pères, entouré du rituel religieux. Dès lors que la guillotine a rencontré le corps du roi, le cadavre appartient à la république : ce sont deux vicaires assermentés, fidèles au nouveau régime, qui officient pour le court service funéraire célébré à la Madeleine.
Le vicaire Damoureau témoigne : « Le corps, mis à découvert dans la bière, fut, d'après les ordres du pouvoir exécutif, jeté au fond de la fosse, sur un lit de chaux vive. La tête fut placée à ses pieds. Le tout fut ensuite couvert d'un lit de chaux vive, puis d'un lit de terre, le tout fortement battu, et à plusieurs reprises. » Il s'agit de corrompre ce corps le plus rapidement possible, afin de dérober les restes à toute vénération et à toute tentative d'enlèvement.
Ce n'est que le 19 janvier 1815, en présence de Mme Royale devenue duchesse d'Angoulême, que l'on déterra officiellement ces restes, qui furent déposés solennellement, le 21 janvier 1815, dans la crypte restaurée de la basilique de Saint-Denis, où était gravée sur une plaque vermeil l'inscription de la tradition : « Ici est le corps du très haut, très puissant et très excellent prince Louis XVIe du nom par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. »
Source: http://www.lhistoire.fr/...