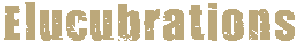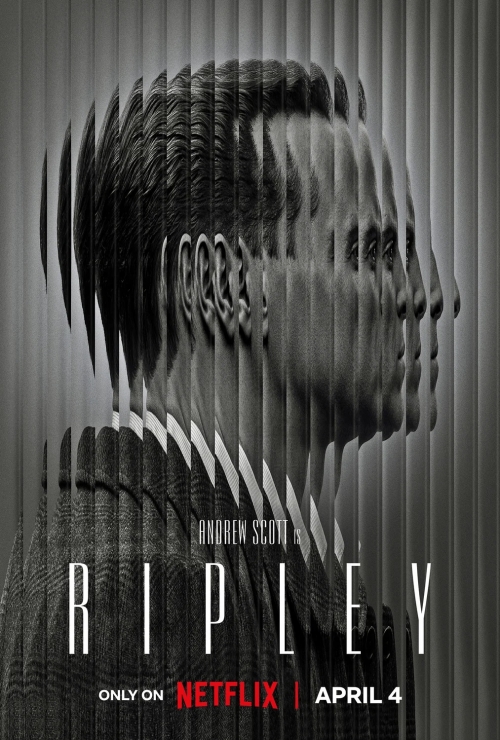Loading...
27
Mar 2010Zéro, ce n'est pas rien
Posté dans Centre de Recherche - Source: http://fr.ado-world.org/...
Un rivage de la Méditerranée, au quatrième siècle de notre ère. Sur une plage déserte, un homme lève un bras impuissant vers le ciel : « Absurde », lâche-t-il, face au soleil couchant. Dans le sable, on distingue encore, tracé d’un geste rageur, l’énoncé du problème qui le fâche : 4 = 4X + 20. Diophante d’Alexandrie, un des plus grands mathématiciens de son temps, créateur d’une famille d’équations (ax + b = c) qui règne encore dans nos manuels scolaires, tourne en rond. Pourtant, il ne faut pas être un expert pour deviner la solution : dans son équation, x égale simplement - 4. Mais Diophante, comme tous ses contemporains, ignore encore l’existence du zéro et des nombres négatifs. Heureux Diophante, qui ne peut pas encore imaginer les krachs boursiers !
L’histoire du zéro est longue et sinueuse. Car le nom même recouvre deux idées très différentes. La première est celle du zéro de position, un outil qui permet de faire la différence, par exemple, entre 91 et 901. La seconde celle du nombre zéro, atypique entre tous : multiplié par n’importe quel chiffre, il donne toujours zéro. Et on ne réussit pas à s’accorder sur ce que donne le résultat d’une division par zéro. Mais une chose est certaine. Sans ce chiffre, la face économique du monde aurait été toute différente : les courbes de l’histoire du zéro épousent étroitement les méandres de l’histoire économique.
La première étape nous mène à Sumer, il y a 5.000 ans. Au musée du Louvre, dans le département de l’histoire assyrienne, se trouve perdue dans une vitrine une petite pierre plate gravée en - 2.300 environ : c’est le décompte des animaux d’une bergerie.
Cette pierre n’est pas rarissime : en Mésopotamie, soit l’Irak et le nord de l’Iran actuels, des dizaines de milliers de tablettes d’argile datant des civilisations sumérienne et babylonienne ont été mises au jour. Le musée de Bagdad en possède (ou en possédait ?) la plus imposante bibliothèque. Pourtant, ces objets sont capitaux : ce sont les premiers témoignages connus d’écriture.
Les plus anciennes tablettes proviennent de la ville d’Uruk, au sud de l’Irak. Elles ne contiennent aucun poème, aucune prière, aucune histoire. Ce sont des documents comptables, rédigés au départ sous forme de pictogrammes, puis en caractères cunéiformes, qui nous sont plus faciles d’accès. A Sumer vers - 3000, l’écriture naît donc d’un besoin de gestion : la riche économie sumérienne, qui s’est développée grâce à un essor agricole extraordinaire, alimenté par les alluvions du Tigre et de l’Euphrate, avait besoin de fixer ses richesses dans l’argile. Et tout au long du troisième millénaire, la manie comptable ira en s’amplifiant.
Une armée de scribes rédigera des milliers de recensements, d’inventaires, d’actes de propriété et de comptes de résultats, étonnants de modernisme : certaines tablettes détaillent ainsi les recettes et les dépenses d’une grande exploitation agricole pendant un an. A la rubrique travaux de vannerie, on trouve le décompte des matières premières utilisées, le prix auquel elles ont été facturées à l’atelier, les jours de travail des ouvriers... De nombreux documents sont relatifs aux temples, qui avaient une vie commerciale très développée. On a retrouvé l’état de la comptabilité annuelle d’un de ces magasins qui portait les montants disponibles en début d’année, les entrée et sorties et le montant à l’issue de l’année.
Les Babyloniens vont pousser plus loin encore la civilisation financière des Sumériens. Pour améliorer la lisibilité de ces documents comptables, ils vont effectuer un pas de géant : ils inventent, aux environs de - 1800, la numérotation de position.
Désormais, la valeur d’un chiffre dépend de sa place dans une série : dans 13 ou 134, la valeur du 3 n’est pas identique. Dans le premier cas, il signifie trois unités, dans le second, trois dizaines. Mais comment faire la différence entre 11 et 101 ? Pendant plus de 1.000 ans, les Babyloniens s’accommoderont sans problème de cette ambiguïté et se fieront au contexte. Puis, vers - 700, sur une tablette de l’ancienne ville de Kish, à l’est de Babylone, apparaissent trois petites entailles qui vont révolutionner le monde. Ces trois encoches, marquent le vide entre deux chiffres. Le zéro de position est né.
Les problèmes mathématiques ont toujours commencé à être posés comme des problèmes réels, explique J.J. O’Connor et E. F. Robertson, deux mathématiciens de l’université écossaise de St Andrew (*).
Il existe, disent-ils, un écart mental gigantesque entre 5 chevaux et 5 « choses ». Puis entre 5 choses et l’idée abstraite de « 5 ». Si des peuplades de l’Antiquité avaient à résoudre un problème concernant le nombre de chevaux dont un fermier avait besoin, la solution n’était pas 0 ou -23 !
L’idée du nombre zéro ne va donc émerger que poussée par la nécessité. Ce sont les marchands indiens qui, petit à petit, ressentent le besoin de disposer d’un instrument plus précis pour traduire de manière correcte leurs opérations commerciales.
Le premier bouleversement a lieu vers -300. Les mathématiciens indiens inventent une manière beaucoup plus pratique de noter les chiffres. A Babylone, on écrivait « 2 » en répétant deux fois l’unité : 2 s’écrivait en gravant deux clous dans l’argile, trois s’écrivait trois clous, etc. Les Indiens révolutionnent la numérotation en inventant les neuf symboles (les chiffres de 1 à 9) que nous utilisons encore aujourd’hui (même si la graphie a évolué : nos chiffres actuels sont les héritiers directs de la graphie arabe des chiffres indiens). Les Indiens redécouvrent ensuite vers le Ve siècle de notre ère, la numérotation de position. Le zéro de position, qui était matérialisé par une encoche à Babylone, est ici marqué d’un point. Il évoluera bientôt pour prendre la forme d’un rond.
Mais l’idée géniale viendra deux siècles plus tard. On la doit vraisemblablement à Brahmagupta (598-670). Ce brillant esprit, fils d’un astronome, nous a légué dans son ½uvre majeure (« Brahmasphutasiddhanta », « L’Ouverture du Monde »), le premier témoignage connu du nombre zéro. Il le définit comme le résultat de la soustraction d’un nombre par lui-même.
Ce qui est frappant, dans le traité de Brahmagupta, est le vocabulaire employé :
Une dette moins zéro est une dette.
Une fortune moins zéro est une fortune.
Le produit de zéro multiplié par une dette ou une fortune est zéro...
Brahmagupta emploie « dette » pour désigner les nombres négatifs et « fortune » pour les nombres positifs. On ne peut pas marquer plus clairement la destination économique de son invention !
Le zéro se fera toutefois coriace : Brahmagupta aura des difficultés en abordant les soustractions. Pour lui, une dette soustraite de zéro est une fortune. Il faudra attendre 200 ans, vers 830, pour qu’un autre mathématicien indien donne la réponse correcte : un nombre reste le même si zéro est soustrait de lui.
En 773, une longue caravane approche des murailles de Bagdad. Une ambassade indienne vient présenter ses lettres de créances au puissant calife Mansour. Dans ses bagages, des livres de calcul. Ils sont donnés en cadeau. Les mathématiciens de la cour d’Al Mansour sont fascinés par la science arithmétique développée sur les bords du Gange. Ils voient aussi le parti qu’ils peuvent en tirer pour améliorer leurs calculs astronomiques qui permettent notamment aux caravanes et aux bateaux des marchands de se repérer en lisant le ciel.
La numérotation indienne est alors rapidement adoptée par le monde arabe. Un savant, Al-Khuwârizmi rédige, vers le IXe siècle, le « Livre de l’addition et de la soustraction d’après le calcul des indiens », qui devient un des « best sellers » de l’époque. A partir du XIIe siècle, le livre sera traduit en latin à plusieurs reprises. Al-Khuwârizmi, latinisé en Algorismus, donnera plus tard algorithme.
Mais entre-temps, un jeune moine, d’origine modeste mais rapidement remarqué par le comte de Barcelone en raison de ses capacités intellectuelles, Gerbert d’Aurillac, prend lui aussi connaissance de la numérotation indienne dans les abbayes catalanes où il poursuit son apprentissage. Gerbert monte rapidement dans la hiérarchie catholique. Il devient pape, sous le nom de Sylvestre II, en 999. Il tente alors d’introduire les chiffres « arabes » dans la chrétienté qui se sert toujours dans ses calculs des chiffres romains, fort peu pratiques. Mais sa tentative se heurte à la résistance acharnée de la puissante caste des clercs. Les clercs, qui sont les seuls à manier avec habileté les chiffres romains au travers d’une sorte de boulier, l’abaque, ne veulent pas se voir détrônés par l’adoption d’une numérotation plus simple et plus accessible. Et surtout, un système venant des païens. Les chiffres arabes sentent le soufre. Gerbert d’Aurillac sera d’ailleurs accompagné, sa vie durant, d’une odeur diabolique. On l’accusera de devoir sa fulgurante carrière à un pacte satanique. Il faudra même ouvrir sa tombe en... 1648, afin de s’assurer qu’elle n’abrite aucun démon !
L’adoption par l’Occident de la numérotation indo-arabe prendra près de cinq siècles. Car à côté de leur caractère diabolique, les chiffres arabes sont aussi plus facilement falsifiables (on confondait facilement le 1 et le 7, par exemple) .
Une fois encore, ce sont les marchands, et surtout les plus puissants d’entre eux, les commerçants italiens, qui vont porter la nouveauté. Le zélateur du zéro sera Léonard de Pise, mieux connu sous le nom de Fibonacci. Son père était un riche marchand de Pise qui gérait pour le compte de sa ville un comptoir en Algérie. Dans un livre rédigé en 1202, « Liber Abacci », Fibonacci, rassemble la somme des connaissances mathématiques de l’époque et introduit la numérotation arabe. Cette nouvelle façon d’écrire les chiffres permet une lecture plus facile, mais aussi un usage plus simple des fractions, ce qui est particulièrement utile dans le calcul des changes .
La dernière conquête du zéro se fera grâce à l’imprimerie qui apparaît en 1434 grâce à Gutenberg. Les erreurs d’écriture deviennent nettement plus difficiles. Le zéro conquiert enfin le monde occidental. Et comme par hasard, quelques décennies plus tard, l’Occident s’ouvrait au nouveau monde (1492, Christophe Colomb) en même temps... qu’à la comptabilité moderne (Luca Pacioli, le grand ami de Léonard de Vinci, introduit en 1494 la comptabilité en double entrée que l’on connaît encore aujourd’hui).
On se demandera pourquoi les Grecs, brillants mathématiciens, sont absents de cette histoire. Il y a plusieurs raisons à cela : la première est que les mathématiciens grecs étaient férus de géométrie, science qui ne réclamait pas un système de notation élaboré. Et puis, la mythologie grecque avait horreur du vide : même avant la création du monde il existait quand même quelque chose, d’informe certes, mais le chaos, ce n’est pas rien.
D’ailleurs zéro se disait en sanscrit sunya, « vide », que les Arabes traduiront en « as-sifr ». Le terme arabe arrive en Europe, d’abord sous la forme de cifra ou zyphra et il aura une double descendance. En français, « sifr » donnera « chiffre ». Mais par ailleurs, Fibonacci latinise zyphra, qui devient zephirum. L’italien dira zefiro. Puis zéro.
L’histoire du zéro est longue et sinueuse. Car le nom même recouvre deux idées très différentes. La première est celle du zéro de position, un outil qui permet de faire la différence, par exemple, entre 91 et 901. La seconde celle du nombre zéro, atypique entre tous : multiplié par n’importe quel chiffre, il donne toujours zéro. Et on ne réussit pas à s’accorder sur ce que donne le résultat d’une division par zéro. Mais une chose est certaine. Sans ce chiffre, la face économique du monde aurait été toute différente : les courbes de l’histoire du zéro épousent étroitement les méandres de l’histoire économique.
La première étape nous mène à Sumer, il y a 5.000 ans. Au musée du Louvre, dans le département de l’histoire assyrienne, se trouve perdue dans une vitrine une petite pierre plate gravée en - 2.300 environ : c’est le décompte des animaux d’une bergerie.
Cette pierre n’est pas rarissime : en Mésopotamie, soit l’Irak et le nord de l’Iran actuels, des dizaines de milliers de tablettes d’argile datant des civilisations sumérienne et babylonienne ont été mises au jour. Le musée de Bagdad en possède (ou en possédait ?) la plus imposante bibliothèque. Pourtant, ces objets sont capitaux : ce sont les premiers témoignages connus d’écriture.
Les plus anciennes tablettes proviennent de la ville d’Uruk, au sud de l’Irak. Elles ne contiennent aucun poème, aucune prière, aucune histoire. Ce sont des documents comptables, rédigés au départ sous forme de pictogrammes, puis en caractères cunéiformes, qui nous sont plus faciles d’accès. A Sumer vers - 3000, l’écriture naît donc d’un besoin de gestion : la riche économie sumérienne, qui s’est développée grâce à un essor agricole extraordinaire, alimenté par les alluvions du Tigre et de l’Euphrate, avait besoin de fixer ses richesses dans l’argile. Et tout au long du troisième millénaire, la manie comptable ira en s’amplifiant.
Une armée de scribes rédigera des milliers de recensements, d’inventaires, d’actes de propriété et de comptes de résultats, étonnants de modernisme : certaines tablettes détaillent ainsi les recettes et les dépenses d’une grande exploitation agricole pendant un an. A la rubrique travaux de vannerie, on trouve le décompte des matières premières utilisées, le prix auquel elles ont été facturées à l’atelier, les jours de travail des ouvriers... De nombreux documents sont relatifs aux temples, qui avaient une vie commerciale très développée. On a retrouvé l’état de la comptabilité annuelle d’un de ces magasins qui portait les montants disponibles en début d’année, les entrée et sorties et le montant à l’issue de l’année.
Les Babyloniens vont pousser plus loin encore la civilisation financière des Sumériens. Pour améliorer la lisibilité de ces documents comptables, ils vont effectuer un pas de géant : ils inventent, aux environs de - 1800, la numérotation de position.
Désormais, la valeur d’un chiffre dépend de sa place dans une série : dans 13 ou 134, la valeur du 3 n’est pas identique. Dans le premier cas, il signifie trois unités, dans le second, trois dizaines. Mais comment faire la différence entre 11 et 101 ? Pendant plus de 1.000 ans, les Babyloniens s’accommoderont sans problème de cette ambiguïté et se fieront au contexte. Puis, vers - 700, sur une tablette de l’ancienne ville de Kish, à l’est de Babylone, apparaissent trois petites entailles qui vont révolutionner le monde. Ces trois encoches, marquent le vide entre deux chiffres. Le zéro de position est né.
Les problèmes mathématiques ont toujours commencé à être posés comme des problèmes réels, explique J.J. O’Connor et E. F. Robertson, deux mathématiciens de l’université écossaise de St Andrew (*).
Il existe, disent-ils, un écart mental gigantesque entre 5 chevaux et 5 « choses ». Puis entre 5 choses et l’idée abstraite de « 5 ». Si des peuplades de l’Antiquité avaient à résoudre un problème concernant le nombre de chevaux dont un fermier avait besoin, la solution n’était pas 0 ou -23 !
L’idée du nombre zéro ne va donc émerger que poussée par la nécessité. Ce sont les marchands indiens qui, petit à petit, ressentent le besoin de disposer d’un instrument plus précis pour traduire de manière correcte leurs opérations commerciales.
Le premier bouleversement a lieu vers -300. Les mathématiciens indiens inventent une manière beaucoup plus pratique de noter les chiffres. A Babylone, on écrivait « 2 » en répétant deux fois l’unité : 2 s’écrivait en gravant deux clous dans l’argile, trois s’écrivait trois clous, etc. Les Indiens révolutionnent la numérotation en inventant les neuf symboles (les chiffres de 1 à 9) que nous utilisons encore aujourd’hui (même si la graphie a évolué : nos chiffres actuels sont les héritiers directs de la graphie arabe des chiffres indiens). Les Indiens redécouvrent ensuite vers le Ve siècle de notre ère, la numérotation de position. Le zéro de position, qui était matérialisé par une encoche à Babylone, est ici marqué d’un point. Il évoluera bientôt pour prendre la forme d’un rond.
Mais l’idée géniale viendra deux siècles plus tard. On la doit vraisemblablement à Brahmagupta (598-670). Ce brillant esprit, fils d’un astronome, nous a légué dans son ½uvre majeure (« Brahmasphutasiddhanta », « L’Ouverture du Monde »), le premier témoignage connu du nombre zéro. Il le définit comme le résultat de la soustraction d’un nombre par lui-même.
Ce qui est frappant, dans le traité de Brahmagupta, est le vocabulaire employé :
Une dette moins zéro est une dette.
Une fortune moins zéro est une fortune.
Le produit de zéro multiplié par une dette ou une fortune est zéro...
Brahmagupta emploie « dette » pour désigner les nombres négatifs et « fortune » pour les nombres positifs. On ne peut pas marquer plus clairement la destination économique de son invention !
Le zéro se fera toutefois coriace : Brahmagupta aura des difficultés en abordant les soustractions. Pour lui, une dette soustraite de zéro est une fortune. Il faudra attendre 200 ans, vers 830, pour qu’un autre mathématicien indien donne la réponse correcte : un nombre reste le même si zéro est soustrait de lui.
En 773, une longue caravane approche des murailles de Bagdad. Une ambassade indienne vient présenter ses lettres de créances au puissant calife Mansour. Dans ses bagages, des livres de calcul. Ils sont donnés en cadeau. Les mathématiciens de la cour d’Al Mansour sont fascinés par la science arithmétique développée sur les bords du Gange. Ils voient aussi le parti qu’ils peuvent en tirer pour améliorer leurs calculs astronomiques qui permettent notamment aux caravanes et aux bateaux des marchands de se repérer en lisant le ciel.
La numérotation indienne est alors rapidement adoptée par le monde arabe. Un savant, Al-Khuwârizmi rédige, vers le IXe siècle, le « Livre de l’addition et de la soustraction d’après le calcul des indiens », qui devient un des « best sellers » de l’époque. A partir du XIIe siècle, le livre sera traduit en latin à plusieurs reprises. Al-Khuwârizmi, latinisé en Algorismus, donnera plus tard algorithme.
Mais entre-temps, un jeune moine, d’origine modeste mais rapidement remarqué par le comte de Barcelone en raison de ses capacités intellectuelles, Gerbert d’Aurillac, prend lui aussi connaissance de la numérotation indienne dans les abbayes catalanes où il poursuit son apprentissage. Gerbert monte rapidement dans la hiérarchie catholique. Il devient pape, sous le nom de Sylvestre II, en 999. Il tente alors d’introduire les chiffres « arabes » dans la chrétienté qui se sert toujours dans ses calculs des chiffres romains, fort peu pratiques. Mais sa tentative se heurte à la résistance acharnée de la puissante caste des clercs. Les clercs, qui sont les seuls à manier avec habileté les chiffres romains au travers d’une sorte de boulier, l’abaque, ne veulent pas se voir détrônés par l’adoption d’une numérotation plus simple et plus accessible. Et surtout, un système venant des païens. Les chiffres arabes sentent le soufre. Gerbert d’Aurillac sera d’ailleurs accompagné, sa vie durant, d’une odeur diabolique. On l’accusera de devoir sa fulgurante carrière à un pacte satanique. Il faudra même ouvrir sa tombe en... 1648, afin de s’assurer qu’elle n’abrite aucun démon !
L’adoption par l’Occident de la numérotation indo-arabe prendra près de cinq siècles. Car à côté de leur caractère diabolique, les chiffres arabes sont aussi plus facilement falsifiables (on confondait facilement le 1 et le 7, par exemple) .
Une fois encore, ce sont les marchands, et surtout les plus puissants d’entre eux, les commerçants italiens, qui vont porter la nouveauté. Le zélateur du zéro sera Léonard de Pise, mieux connu sous le nom de Fibonacci. Son père était un riche marchand de Pise qui gérait pour le compte de sa ville un comptoir en Algérie. Dans un livre rédigé en 1202, « Liber Abacci », Fibonacci, rassemble la somme des connaissances mathématiques de l’époque et introduit la numérotation arabe. Cette nouvelle façon d’écrire les chiffres permet une lecture plus facile, mais aussi un usage plus simple des fractions, ce qui est particulièrement utile dans le calcul des changes .
La dernière conquête du zéro se fera grâce à l’imprimerie qui apparaît en 1434 grâce à Gutenberg. Les erreurs d’écriture deviennent nettement plus difficiles. Le zéro conquiert enfin le monde occidental. Et comme par hasard, quelques décennies plus tard, l’Occident s’ouvrait au nouveau monde (1492, Christophe Colomb) en même temps... qu’à la comptabilité moderne (Luca Pacioli, le grand ami de Léonard de Vinci, introduit en 1494 la comptabilité en double entrée que l’on connaît encore aujourd’hui).
On se demandera pourquoi les Grecs, brillants mathématiciens, sont absents de cette histoire. Il y a plusieurs raisons à cela : la première est que les mathématiciens grecs étaient férus de géométrie, science qui ne réclamait pas un système de notation élaboré. Et puis, la mythologie grecque avait horreur du vide : même avant la création du monde il existait quand même quelque chose, d’informe certes, mais le chaos, ce n’est pas rien.
D’ailleurs zéro se disait en sanscrit sunya, « vide », que les Arabes traduiront en « as-sifr ». Le terme arabe arrive en Europe, d’abord sous la forme de cifra ou zyphra et il aura une double descendance. En français, « sifr » donnera « chiffre ». Mais par ailleurs, Fibonacci latinise zyphra, qui devient zephirum. L’italien dira zefiro. Puis zéro.
Source: http://fr.ado-world.org/...