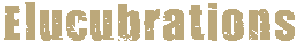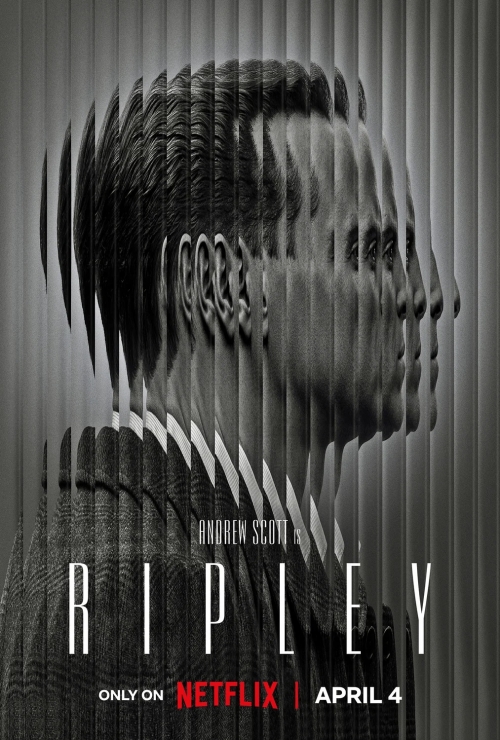Loading...

On a l’habitude de dire qu’une oeuvre ne doit pas grand-chose au hasard. Qu’elle se comprend en fonction de son contexte qui permet d’apprécier ses influences, de dégager ses filiations et d’appréhender ses ambitions. Boardwalk Empire commence sur HBO au moment où Mad Men achève bientôt sa quatrième saison sur AMC. Après des débuts qui la virent passer presque inaperçue, seulement soutenue par les critiques enthousiastes et fidèles, la série de Matthew Weiner est devenue un succès mondial. Elle s’est transformée en un phénomène passionnel et un sujet d’études. On fait l’exégèse de chaque épisode comme celle de textes sacrés et l’on commente cette inattendue réussite à longueur de colonnes, se demandant si elle n’est pas quand même imméritée.
Le parallèle entre les publicitaires newyorkais du début des années 60 et les gangsters du New Jersey du début des années 20 est tentant, mais surtout il s’impose. Ce que nous propose HBO, ce n’est rien de moins qu’une fresque historique, la découverte d’une époque au travers d’une fiction. Une manière de remonter le temps et de se remémorer des événements et des noms qui appartiennent désormais aux étagères des bibliothèques. Le reproche fait à Mad Men est de pincer la corde de la nostalgie et de souffrir d’une forme de vacuité. Mêlant des destins individuels aux faits marquants et tragiques d’un autre temps, elle ne cesse d’accomplir des allers-retours entre ces deux pôles, se contentant d’effleurer des souvenirs connus tout en faisant mine de les redécouvrir et de mettre en perspective leur importance.
Pour Boardwalk Empire, le côté nostalgique risque de concerner peu de monde, compte tenu de l’éloignement temporel. Pourtant la démarche obéit à la même logique: revisiter une époque qui marqua un tournant majeur dans l’histoire des Etats-Unis. L’entrée en vigueur du Volstead Act le 16 janvier 1920 à 00h00 signa le début de la Prohibition, autrement dit la réglementation de la vente d’alcool, mesure ratifiée par 36 Etats de l’Union. Cette loi restrictive, soutenue par les associations conservatrices féministes (comme la Woman’s Christian Temperance Union), va certes mener à une diminution de la consommation, mais portant en elle un effet pervers largement prévisible, elle va favoriser l’émergence d’un trafic et le développement d’un crime organisé qui y trouve une nouvelle source de financement. L’une des grandes leçons (qui a d’étranges échos encore aujourd’hui) est que la restriction de libertés obéissant aux attentes des braves gens (avec ce mythe dévastateur de la sagesse populaire) est génératrice de criminalité.
Lors d’une journée d’étude organisée au mois de juin par le département d’Histoire et Pratiques de la Culture Populaire de Sciences-Po, le professeur Gary Edgerton de la Old Dominion University à Norfolk en Virginie soulignait la filiation qui existait entre The Sopranos et Mad Men. Matthew Weiner avait été scénariste dans la série de David Chase avant de se lancer dans une aventure personnelle. On pouvait également tisser un lien entre le cacractère nostalgique des deux fictions, et le tempérament de leur héros principal. Il est intéressant de noter qu’une filiation assez similaire existe avec Boardwalk Empire et pas seulement parce que cela parle de membres du crime organisé.
La succession ouverte des Sopranos
Son créateur et scénariste, Terence Winter, a lui aussi travaillé aux côtés de Chase. Steve Buscemi apparaissait dans 16 épisodes pour incarner Tony Blundetto, un cousin de Tony Soprano. Buscemi se trouvait derrière la caméra pour quatre épisodes de la série dont Pine Barrens écrit par Terence Winter et qui est considéré comme l’un des meilleurs jamais réalisés. Certains font également remarquer la proximité qui existait entre l’univers des Sopranos et l’oeuvre de Martin Scorsese, producteur de Boardwalk (les planches qui se trouvent sur le front de mer à Atlantic City) et réalisateur du premier des 12 épisodes.
C’est la première fois que le maître et père de Taxi Driver s’implique aussi longuement et largement dans une fiction télévisée. Il avait certes contribué à la direction du documentaire sur le blues (en 2003) et était apparu en tant que lui-même dans quelques épisodes de comédies (30 Rock, Curb Your Enthusiasm et Entourage). Avec ce projet, Scorsese contribue à son tour au rapprochement entre le petit et le grand écran, mais surtout, il vient offrir au Home Box Office ce que la chaîne cherchait depuis plusieurs années. Depuis la fin des Sopranos, HBO est l’objet d’une attention quelque peu maladive. Chaque nouveau projet est observé, décortiqué, disséqué et comparé aux Sopranos, série que l’on peut (à tort ou à raison) considérer comme le point de départ d’une ère exceptionnellement riche et fertile pour les fictions télévisées.
Sur ce terreau, ont grandi des chaînes comme Showtime, FX ou encore AMC qui se sont mises concurrencer et contester la position enviable qu’occupait HBO avec ce constat récurrent: les nouveaux venus faisaient de mieux en mieux (il suffit de voir l’engouement pour Mad Men, Breaking Bad ou The Shield) tandis que l’aînée faisait de moins en moins bien. Ses récents projets n’avaient pas le souffle et l’ambition d’autrefois. Il suffit pour s’en convaincre de lire les critiques de The Pacific (que l’on doit à Steven Spielberg et Tom Hanks) ou celles de True Blood (oeuvre d’Alan Ball, créateur de Six Feet Under). Sans jamais être de mauvaise facture (mais peut-être y a-t-il un a priori trop favorable), ces séries demeuraient d’une qualité et d’une portée moindre. Cela dit, il n’est pas possible de produire des chefs d’oeuvre à la chaîne.
Il est prématuré d’affirmer que Boardwalk Empire possède tout ce qu’il faut pour succèder aux Sopranos. L’heure du bilan est encore loin. Cela dit, la présence de Scorsese constitue une garantie de qualité et surtout d’ambition. C’est toujours de la télévision, mais c’est déjà un peu autre chose. Avec le souci d’une oeuvre aux allures cinématographiques et historiques. Cette tendance s’affirme de plus en plus. Si la première décennie du XXIe siècle fut celle des feuilletons, on peut se demander si la deuxième ne sera pas celle d’un regain d’intérêt pour l’histoire, quelle que soit l’époque explorée.
Pas la moitié d’un gangster
Steve Buscemi est Enoch “Nucky” Thompson, personnage central inspiré d’Enoch L. Johnson, homme politique influent du camp républicain et membre du crime organisé qui régna sur Atlantic City jusqu’à son emprisonnement en 1941. La Prohibition vient pour lui comme une bénédiction. Il l’accueille à bras ouverts, avec la conviction qu’elle est l’assurance d’un enrichissement prochain. L’alcool va se vendre encore mieux et encore plus cher maintenant qu’il est déclaré illégal. Il suffit d’organiser la contrebande à partir du Canada ou d’ouvrir des distilleries clandestines pour fabriquer un whisky qui n’en a que le nom.
Nucky, comme Tony Soprano et comme Don Draper, est un personnage ambivalent. Il est capable de raconter avec une parfaite aisance et sans aucune mauvaise conscience une histoire inventée de toutes pièces devant une assemblée de mères de famille pour dénoncer les ravages de l’alcool. Et il est capable d’ordonner l’assassinat (par les agents de son frère Elias, responsable de la police locale) d’un mari qui maltraite sa femme enceinte. Il négocie avec les truands venus de Chicago et de New York et il s’apitoye sur le sort d’enfants prématurés. Il est convaincu de son destin et il doute de ce que l’avenir lui réserve.
Il est cynique quand il affirme: “First rule of politics, kiddo. Never let the truth get in the way of a good story“. Et il est d’une loyauté infaillible lorsque son protégé, Jimmy Darmody (Michael Pitt), de retour des tranchées de la Première guerre mondiale, le trahit. Inflexible en affaires (Nucky Johnson mesurait plus de 1,90 mètres pour près de 120 kg), il fait preuve d’une forme de compassion quand il s’agit de ses affaires privées. Au point que Jimmy doit lui rappeler une évidence qu’il n’a pas tout à fait envie d’entendre, qu’il n’a pas tout à fait envie d’admettre, une évidence qui lui annonce qu’il est à l’aube de nouvelle époque. “You can’t be half a gangster, Nucky. Not anymore.“
Dans ce monde en changement (encore marqué par les stigmates du conflit en Europe qui aura de nombreuses répercussions sociales aux Etats-Unis), apparaissent des figures comme Big Jim Colosimo, propriétaire de clubs et de restaurants à Chicago où il régnait en maître sur la prostitution dans le quartier de Levee. Colosimo ne fut jamais intéressé par la contrebande, il pensait que les maisons closes devaient rester le coeur de son commerce. Il faut dire que la Ville des Vents possèdait alors l’un des plus célèbres bordels d’Amérique, le Everleigh Club, tenu par deux soeurs.
Colosimo appartient donc au passé, au XIXe siècle, et sa disparition est aussi prévisible qu’elle est parfaitement filmée dans le respect des grands films de gangsters. De même, Lucky Luciano incarne la nouvelle génération, impatiente de prendre le pouvoir et qui réussit à s’imposer. Il deviendra le parrain de l’une des cinq familles de la Cosa Nostra de New York. Arnold Rothstein est lui le trait d’union entre ces deux générations tandis qu’en ce début de 1920, Al Capone n’est encore qu’un porte-flingue.
Le parallèle entre les publicitaires newyorkais du début des années 60 et les gangsters du New Jersey du début des années 20 est tentant, mais surtout il s’impose. Ce que nous propose HBO, ce n’est rien de moins qu’une fresque historique, la découverte d’une époque au travers d’une fiction. Une manière de remonter le temps et de se remémorer des événements et des noms qui appartiennent désormais aux étagères des bibliothèques. Le reproche fait à Mad Men est de pincer la corde de la nostalgie et de souffrir d’une forme de vacuité. Mêlant des destins individuels aux faits marquants et tragiques d’un autre temps, elle ne cesse d’accomplir des allers-retours entre ces deux pôles, se contentant d’effleurer des souvenirs connus tout en faisant mine de les redécouvrir et de mettre en perspective leur importance.
Pour Boardwalk Empire, le côté nostalgique risque de concerner peu de monde, compte tenu de l’éloignement temporel. Pourtant la démarche obéit à la même logique: revisiter une époque qui marqua un tournant majeur dans l’histoire des Etats-Unis. L’entrée en vigueur du Volstead Act le 16 janvier 1920 à 00h00 signa le début de la Prohibition, autrement dit la réglementation de la vente d’alcool, mesure ratifiée par 36 Etats de l’Union. Cette loi restrictive, soutenue par les associations conservatrices féministes (comme la Woman’s Christian Temperance Union), va certes mener à une diminution de la consommation, mais portant en elle un effet pervers largement prévisible, elle va favoriser l’émergence d’un trafic et le développement d’un crime organisé qui y trouve une nouvelle source de financement. L’une des grandes leçons (qui a d’étranges échos encore aujourd’hui) est que la restriction de libertés obéissant aux attentes des braves gens (avec ce mythe dévastateur de la sagesse populaire) est génératrice de criminalité.
Lors d’une journée d’étude organisée au mois de juin par le département d’Histoire et Pratiques de la Culture Populaire de Sciences-Po, le professeur Gary Edgerton de la Old Dominion University à Norfolk en Virginie soulignait la filiation qui existait entre The Sopranos et Mad Men. Matthew Weiner avait été scénariste dans la série de David Chase avant de se lancer dans une aventure personnelle. On pouvait également tisser un lien entre le cacractère nostalgique des deux fictions, et le tempérament de leur héros principal. Il est intéressant de noter qu’une filiation assez similaire existe avec Boardwalk Empire et pas seulement parce que cela parle de membres du crime organisé.
La succession ouverte des Sopranos
Son créateur et scénariste, Terence Winter, a lui aussi travaillé aux côtés de Chase. Steve Buscemi apparaissait dans 16 épisodes pour incarner Tony Blundetto, un cousin de Tony Soprano. Buscemi se trouvait derrière la caméra pour quatre épisodes de la série dont Pine Barrens écrit par Terence Winter et qui est considéré comme l’un des meilleurs jamais réalisés. Certains font également remarquer la proximité qui existait entre l’univers des Sopranos et l’oeuvre de Martin Scorsese, producteur de Boardwalk (les planches qui se trouvent sur le front de mer à Atlantic City) et réalisateur du premier des 12 épisodes.
C’est la première fois que le maître et père de Taxi Driver s’implique aussi longuement et largement dans une fiction télévisée. Il avait certes contribué à la direction du documentaire sur le blues (en 2003) et était apparu en tant que lui-même dans quelques épisodes de comédies (30 Rock, Curb Your Enthusiasm et Entourage). Avec ce projet, Scorsese contribue à son tour au rapprochement entre le petit et le grand écran, mais surtout, il vient offrir au Home Box Office ce que la chaîne cherchait depuis plusieurs années. Depuis la fin des Sopranos, HBO est l’objet d’une attention quelque peu maladive. Chaque nouveau projet est observé, décortiqué, disséqué et comparé aux Sopranos, série que l’on peut (à tort ou à raison) considérer comme le point de départ d’une ère exceptionnellement riche et fertile pour les fictions télévisées.
Sur ce terreau, ont grandi des chaînes comme Showtime, FX ou encore AMC qui se sont mises concurrencer et contester la position enviable qu’occupait HBO avec ce constat récurrent: les nouveaux venus faisaient de mieux en mieux (il suffit de voir l’engouement pour Mad Men, Breaking Bad ou The Shield) tandis que l’aînée faisait de moins en moins bien. Ses récents projets n’avaient pas le souffle et l’ambition d’autrefois. Il suffit pour s’en convaincre de lire les critiques de The Pacific (que l’on doit à Steven Spielberg et Tom Hanks) ou celles de True Blood (oeuvre d’Alan Ball, créateur de Six Feet Under). Sans jamais être de mauvaise facture (mais peut-être y a-t-il un a priori trop favorable), ces séries demeuraient d’une qualité et d’une portée moindre. Cela dit, il n’est pas possible de produire des chefs d’oeuvre à la chaîne.
Il est prématuré d’affirmer que Boardwalk Empire possède tout ce qu’il faut pour succèder aux Sopranos. L’heure du bilan est encore loin. Cela dit, la présence de Scorsese constitue une garantie de qualité et surtout d’ambition. C’est toujours de la télévision, mais c’est déjà un peu autre chose. Avec le souci d’une oeuvre aux allures cinématographiques et historiques. Cette tendance s’affirme de plus en plus. Si la première décennie du XXIe siècle fut celle des feuilletons, on peut se demander si la deuxième ne sera pas celle d’un regain d’intérêt pour l’histoire, quelle que soit l’époque explorée.
Pas la moitié d’un gangster
Steve Buscemi est Enoch “Nucky” Thompson, personnage central inspiré d’Enoch L. Johnson, homme politique influent du camp républicain et membre du crime organisé qui régna sur Atlantic City jusqu’à son emprisonnement en 1941. La Prohibition vient pour lui comme une bénédiction. Il l’accueille à bras ouverts, avec la conviction qu’elle est l’assurance d’un enrichissement prochain. L’alcool va se vendre encore mieux et encore plus cher maintenant qu’il est déclaré illégal. Il suffit d’organiser la contrebande à partir du Canada ou d’ouvrir des distilleries clandestines pour fabriquer un whisky qui n’en a que le nom.
Nucky, comme Tony Soprano et comme Don Draper, est un personnage ambivalent. Il est capable de raconter avec une parfaite aisance et sans aucune mauvaise conscience une histoire inventée de toutes pièces devant une assemblée de mères de famille pour dénoncer les ravages de l’alcool. Et il est capable d’ordonner l’assassinat (par les agents de son frère Elias, responsable de la police locale) d’un mari qui maltraite sa femme enceinte. Il négocie avec les truands venus de Chicago et de New York et il s’apitoye sur le sort d’enfants prématurés. Il est convaincu de son destin et il doute de ce que l’avenir lui réserve.
Il est cynique quand il affirme: “First rule of politics, kiddo. Never let the truth get in the way of a good story“. Et il est d’une loyauté infaillible lorsque son protégé, Jimmy Darmody (Michael Pitt), de retour des tranchées de la Première guerre mondiale, le trahit. Inflexible en affaires (Nucky Johnson mesurait plus de 1,90 mètres pour près de 120 kg), il fait preuve d’une forme de compassion quand il s’agit de ses affaires privées. Au point que Jimmy doit lui rappeler une évidence qu’il n’a pas tout à fait envie d’entendre, qu’il n’a pas tout à fait envie d’admettre, une évidence qui lui annonce qu’il est à l’aube de nouvelle époque. “You can’t be half a gangster, Nucky. Not anymore.“
Dans ce monde en changement (encore marqué par les stigmates du conflit en Europe qui aura de nombreuses répercussions sociales aux Etats-Unis), apparaissent des figures comme Big Jim Colosimo, propriétaire de clubs et de restaurants à Chicago où il régnait en maître sur la prostitution dans le quartier de Levee. Colosimo ne fut jamais intéressé par la contrebande, il pensait que les maisons closes devaient rester le coeur de son commerce. Il faut dire que la Ville des Vents possèdait alors l’un des plus célèbres bordels d’Amérique, le Everleigh Club, tenu par deux soeurs.
Colosimo appartient donc au passé, au XIXe siècle, et sa disparition est aussi prévisible qu’elle est parfaitement filmée dans le respect des grands films de gangsters. De même, Lucky Luciano incarne la nouvelle génération, impatiente de prendre le pouvoir et qui réussit à s’imposer. Il deviendra le parrain de l’une des cinq familles de la Cosa Nostra de New York. Arnold Rothstein est lui le trait d’union entre ces deux générations tandis qu’en ce début de 1920, Al Capone n’est encore qu’un porte-flingue.
Source: http://seriestv.blog.lemonde.fr/...