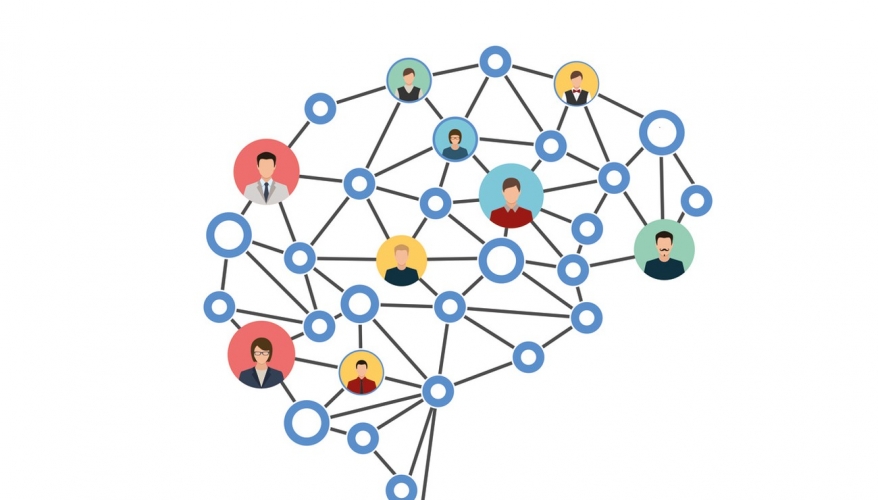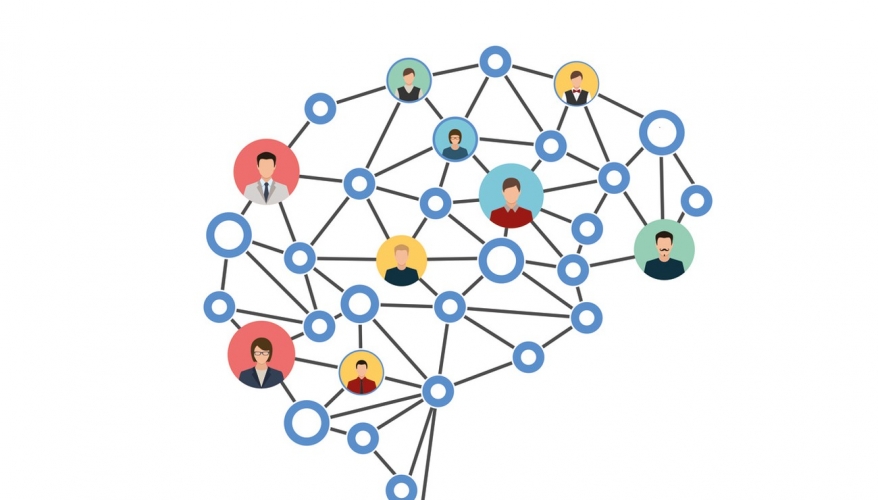
Où se situe votre collègue de bureau dans la hiérarchie de votre entreprise ? Votre boulanger est-il plus proche de vous socialement que votre voisin de palier ? Toutes ces informations sont cartographiées par la même zone du cerveau qui vous aide à vous repérer dans le métro ou sur un plan !
n nous dit souvent qu’il n’y a pas de raccourcis dans la vie. Mais le cerveau – même celui d’un rat – ignore complètement ce genre de conseils. En fait, c’est une véritable machine à trouver des raccourcis.
En 1948, Edward Tolman, de l’université de Californie, à Berkeley, réalise une curieuse expérience où un rat affamé est placé sur une table ronde au bout de laquelle s’ouvre un couloir sombre et étroit. L’animal s’y engage, tourne à gauche, puis deux fois à droite, avant de courir le long d’une étroite bande bien éclairée. Au bout de ce périple l’attend une tasse de nourriture. Il n’y a aucun choix à faire : le rat doit suivre le seul chemin possible. Et il le fait, encore et encore, pendant quatre jours.
Un concept clé : les cartes cognitives
Mais le cinquième jour, le décor a changé. Il y a toujours le couloir principal face à lui, mais également 18 autres embranchements qui partent du centre pour se diriger vers la périphérie de la table. L’animal, naturellement, prend le couloir principal car il sait que celui-ci mène à la nourriture. Mais très vite, il se heurte à un mur : ce chemin a été obturé. Il revient donc sur ses pas et commence à chercher des alternatives. Il fait quelques pas dans des branches secondaires, puis se décide brusquement et court vers la sixième à gauche du couloir. Et c’est celle qui mène à la nourriture !
Pour les psychologues de l’époque, ce comportement du rat représente un exploit remarquable. En effet, la principale théorie sur l’apprentissage des animaux postulait alors que les agissements d’un rat placé dans un labyrinthe reposent uniquement sur la construction de liens entre des stimuli et des réponses comportementales. Toujours selon cette théorie, lorsque le comportement adopté face à un stimulus présent dans l’environnement est couronné de succès, les connexions neurales qui représentent cette association se renforcent.
Dans une telle optique, le cerveau fonctionne comme un standard téléphonique, qui ne maintient que les connexions les plus robustes et les plus fiables entre les appels entrants de nos organes sensoriels et les messages sortants vers les muscles. Mais ce modèle est incapable d’expliquer la capacité du rat à choisir correctement un raccourci dès le départ, sans l’avoir expérimenté au préalable. C’est alors qu’une école de pensée rivale a proposé une autre solution : au cours de l’apprentissage, une carte s’établit dans le cerveau du rat. Edward Tolman, partisan de cette école, lui donnera un nom : « carte cognitive ».
Selon Tolman, le cerveau fait plus qu’apprendre des associations. En effet, ces associations sont souvent fragiles et rendues obsolètes par les modifications de l’environnement. Les décennies de recherches suivantes ont confirmé sa théorie : le cerveau construit, stocke et utilise des cartes mentales. Ces modèles du monde nous permettent de naviguer dans un environnement complexe et changeant, tout en utilisant des raccourcis ou des détours selon les besoins. Le rat affamé de l’expérience de Tolman a dû se souvenir de l’emplacement de la nourriture et en déduire l’angle du chemin qui y menait. Autrement dit, il a construit un modèle mental de son environnement.
Cette modélisation (ou cartographie) ne se limite pas à l’espace physique. Les cartes mentales sont au c½ur de nombre de nos capacités, y compris les plus « humaines » : l’imagination, la déduction, le raisonnement abstrait, la mémoire, la construction d’un réseau social… Mais comment le cerveau les crée-t-il ?
Premières découvertes sur les cartes mentales...
C’est dans les années 1970 que les chercheurs ont commencé à mettre au jour la base neurale des cartes mentales. En étudiant l’hippocampe dans le cerveau de rongeurs, John O’Keefe, de l’University College de Londres, et son étudiant Jonathan Dostrovsky ont découvert une classe particulière de neurones qui s’activent lorsque les souris occupent des emplacements spécifiques dans leur environnement. Certains s’allument à un endroit donné, et d’autres à l’étape suivante de son chemin, comme si leur rôle était de localiser l’animal dans l’espace. En analysant les séquences de ces « cellules de lieu », les chercheurs ont réussi à reconstituer la trajectoire des souris. Les travaux réalisés par la suite ont confirmé l’existence de cellules de lieu chez d’autres animaux, y compris chez l’homme, et ont clarifié un grand nombre de leurs propriétés. Ils ont aussi mis en évidence une multitude d’autres types de cellules qui contribuent à l’encodage des représentations spatiales par le cerveau.
La deuxième étape majeure fut l’½uvre d’une équipe dirigée par un couple de chercheurs, Edvard et May-Britt Moser, qui avaient effectué un post-doctorat au laboratoire d’O’Keefe quelque temps auparavant. Ces scientifiques ont découvert des neurones très semblables aux cellules de lieu dans le cortex entorhinal, une région voisine de l’hippocampe et qui lui est reliée. Ces neurones s’activent également selon l’emplacement où se trouve un animal, mais contrairement aux cellules de lieu, chacun s’allume à de multiples endroits, qui sont régulièrement espacés et forment des triangles équilatéraux. Autrement dit, ils s’activent lorsque l’animal passe au-dessus des sommets de triangles. Ces neurones furent donc baptisés « cellules de grille », car leur schéma d’activité semble dessiner une grille maillant l’espace, une sorte de métrique spatiale.
… et prix Nobel pour les chercheurs
Ces découvertes ont soulevé l’enthousiasme – O’Keefe et le couple Moser ont reçu à ce titre le prix Nobel de médecine et de physiologie en 2014 –, car un modèle commençait à émerger sur la façon dont le cerveau contrôle la navigation. Les cellules de lieu et de grille fourniraient un moyen de se situer dans l’espace et de déterminer la distance et la direction. Ces outils de navigation sont essentiels à la construction de cartes mentales.
Mais pour créer ces dernières, le cerveau utilise bien d’autres informations, majoritairement codées par le système hippocampique-entorhinal. Lorsqu’un animal se dirige vers un objectif, par exemple, certains neurones de l’hippocampe s’activent d’une façon qui dépend de la direction et de la distance à parcourir pour l’atteindre. Plus précisément, ils s’allument de plus en plus vite à mesure que l’animal s’approche de son but.
De nombreuses autres cellules participent aux cartes mentales. Des « cellules de récompense » encodent ainsi les lieux d’intérêt, fournissant un signal pour guider la navigation (pensez à une croix marquant l’endroit du trésor sur la carte d’un pirate). D’autres neurones analysent la vitesse et la direction du déplacement, agissant comme des compteurs et des boussoles internes. D’autres cellules encore signalent l’emplacement de points de repère, qui servent de référence pour corriger les erreurs de trajectoire. Enfin, des neurones spécifiques s’activent davantage lorsque l’animal s’approche des bords de sa carte mentale…
Cette variété de cellules est d’un intérêt évident pour nous tous : notre cerveau doit connaître l’emplacement de notre domicile, de notre bureau, de la maison de nos parents ou d’une série de magasins, et il doit être en mesure de s’y rendre en évitant les impasses et sens interdits. On ignore comment toutes ces informations sont rassemblées en une carte cohérente, mais ces cellules semblent fournir les ingrédients de base.
Plus qu’un simple cartographe
Le système hippocampique-entorhinal est cependant plus qu’un simple cartographe, et les cartes bien davantage qu’un moyen de se situer dans l’espace. Leur utilisation permet une planification active. Lorsqu’un rat arrive à un point de jonction dans un labyrinthe familier, il s’arrête pendant que les cellules de lieu qui se rapportent aux différentes options s’activent, comme si l’animal contemplait mentalement les choix possibles.
Les humains utilisent des mécanismes similaires, comme l’ont montré des recherches où les participants naviguaient dans des environnements virtuels tandis que leur activité cérébrale était mesurée par résonance magnétique fonctionnelle. L’activité de leur hippocampe révélait en effet qu’ils visualisaient et planifiaient les itinéraires possibles.
Au-delà des chemins physiques, l’exploration des options existantes survient aussi pendant le sommeil. En effet, les cellules de lieu se réactivent alors pour rejouer le passé et simuler l’avenir. Une faculté précieuse pour tester virtuellement de nouveaux comportements. Sans elles, nous devrions systématiquement essayer une multitude d’options avant de décider quoi faire. Nous serions des empiristes permanents, ne pouvant agir que sur la base d’observations directes. Les simulations nous donnent au contraire la capacité d’envisager des possibilités variées sans les expérimenter réellement.
Voyage mental dans le temps
Le même système hippocampique-entorhinal suit le mouvement à travers le temps, comme l’ont montré des travaux principalement effectués par l’équipe de feu Howard Eichenbaum, à l’université de Boston. Il s’y trouve en effet des « cellules temporelles » qui s’activent aux moments successifs de l’expérience d’un animal. Ces neurones ne fonctionnent toutefois pas comme une simple horloge. Ils créent plutôt des sortes de repères temporels, par exemple en s’activant plus ou moins longtemps si la durée d’une tâche change. Notons que certaines de ces cellules codent également l’espace physique, qui semble donc lié à l’espace temporel dans le cerveau. Dans le langage courant aussi, le temps et l’espace sont inextricablement associés, comme l’illustrent nombre de métaphores – le temps « passe », nous regardons « en avant » vers l’avenir et « en arrière » vers le passé, etc.
Ces découvertes n’ont pas été une surprise totale : les psychologues soupçonnaient depuis longtemps l’importance de ces zones cérébrales pour la perception de l’espace et du temps. En 1953, un patient épileptique nommé Henry Molaison a subi une ablation chirurgicale des deux hippocampes (un dans chaque hémisphère), afin de réduire les crises qui lui gâchaient la vie. L’opération a bien réussi à les faire disparaître, mais au prix d’un handicap cognitif spectaculaire qui a fait de Molaison – connu pendant des décennies par ses seules initiales H. M. – l’un des cas les plus célèbres de la neurologie.
Le patient se souvenait plutôt bien de ce qu’il avait connu avant l’opération, mais il ne parvenait plus à mémoriser les nouvelles expériences. Il oubliait immédiatement les personnes qu’il rencontrait, les faits qu’il découvrait ou les événements qu’il vivait. Malgré tout, il restait capable de certains types d’apprentissage, par exemple moteurs, s’il s’entraînait suffisamment.
En observant Molaison, les neuroscientifiques ont constaté que l’hippocampe était essentiel pour enregistrer les souvenirs des faits et des événements – qui sont stockés dans ce qu’on appelle la « mémoire épisodique ». Les recherches sur le rôle de l’hippocampe dans cette forme de mémoire se sont multipliées en même temps que les études sur ses fonctions cartographiques.
Tous ces travaux ont représenté une étape importante pour au moins deux raisons. D’abord, les recherches sur la navigation spatiale chez les rongeurs ont livré la première découverte des corrélats neuronaux d’une fonction cognitive d’ordre supérieur – c’est-à-dire qui va au-delà des processus sensoriels de base. Ensuite, le patient H. M. nous a montré qu’il existe de multiples types de mémoire, sous-tendus par des systèmes neuronaux au moins partiellement différents, et que l’hippocampe joue un rôle central dans la formation et le stockage de souvenirs épisodiques.
Au final, ces découvertes suggèrent que la mémoire épisodique repose sur des mécanismes de navigation spatiale et temporelle. Une idée peut-être mieux exprimée dans la théorie proposée des décennies plus tôt par Tolman : tant la mémoire épisodique que la navigation spatiale pourraient refléter la formation et l’utilisation de cartes cognitives par le cerveau.
Un résumé du monde
Les cartes ne sont pas des portraits précis du monde dans toute sa complexité. Elles représentent plutôt des relations – comme les distances et les directions entre les lieux. Elles résument une quantité étourdissante d’informations dans un format simple et facile à lire, qui autorise une navigation souple et efficace. Les types de cellules mentionnés plus haut (cellules de lieu, de grille et de frontière, entre autres) rassemblent ces éléments connexes en une carte que d’autres régions du cerveau lisent ensuite pour guider la prise de décision d’une façon adaptée à l’environnement. La cartographie permet de déduire des relations qui n’ont pas été expérimentées et de prendre des raccourcis mentaux. Ceux-ci dépassent le cadre des domaines spatial et temporel : peut-être même que le raisonnement abstrait dépend en partie des fondements neuronaux mis en évidence dans ces travaux.
Les travaux d’Alexandra Constantinescu, Jill O’Reilly et Timothy Behrens, alors à l’université d’Oxford, s’inscrivent dans cette nouvelle ligne de recherche. Dans une étude, ils ont demandé aux participants d’apprendre des associations entre différents symboles et des images d’oiseaux ayant des longueurs de cou et de pattes variées. Un oiseau au long cou et aux courtes pattes était par exemple associé à l’image d’une cloche, tandis qu’un volatile au cou rétréci et aux pattes allongées était associé à un ours en peluche. Ces liens ont créé un espace d’association bidimensionnel (l’espace « oiseau », où chaque symbole pouvait être placé dans un repère avec la longueur du cou en abscisse et la longueur des pattes en ordonnée).
Les participants ont ensuite subi un test pour évaluer leur apprentissage, tandis que leur activité cérébrale était mesurée. Bien que la neuroimagerie ne soit pas assez précise pour détecter individuellement les cellules de grille dans le cerveau humain, elle a révélé un schéma d’activation qui ressemblait à celui de ces cellules au sein du cortex entorhinal. Cette analyse s’appuyait sur des travaux antérieurs réalisés par Christian Doeller, de l’institut Max-Planck, à Leipzig, et de Neil Burgess, de l’University College de Londres, qui ont été les premiers à déceler une activité de ce type dans le cortex entorhinal d’humains naviguant dans un labyrinthe virtuel.
Tout se passe donc comme si, pour se remémorer une association, les participants naviguaient dans l’espace abstrait « oiseau » et le balisaient à l’aide d’une grille. Ce codage de l’information est très efficace, tant pour les relations physiques que pour les relations abstraites. Il rend les liens entre les lieux ou les concepts plus faciles à prévoir, améliorant ainsi la rapidité avec laquelle on tire des conclusions sur ces relations. Comme dans l’espace physique, cette organisation de l’information permet de déduire des raccourcis – dont pourraient dépendre les liens que nous établissons entre les idées, les analogies et les stéréotypes que nous créons, et, d’une façon plus générale, notre créativité.
Une cartographie sociale
Les relations sociales, elles aussi, sont des notions plus abstraites que l’espace physique. Comment le cerveau les représente-t-il ? Le concept d’une personne regroupe un certain nombre d’éléments : son nom, son apparence physique, sa personnalité… Lorsque nous voyons sa photo, des cellules particulières de l’hippocampe s’activent, et ces mêmes cellules s’allument si nous entendons ou lisons son nom. Elles sont donc chargées de représenter des concepts d’individus spécifiques, indépendamment du stimulus sensoriel que nous percevons (dans une étude célèbre, Itzhak Fried, de l’université de Californie, à Los Angeles, et ses collègues avaient ainsi découvert un neurone associé à l’actrice Jennifer Aniston).
D’autres cellules de l’hippocampe, appelées « cellules de lieu sociales », suivent l’emplacement physique des personnes qui nous entourent. Une équipe israélienne menée par David Omer et Nachum Ulanovsky, respectivement à l’université hébraïque de Jérusalem et à l’institut Weizmann des sciences, l’a étudié chez des chauves-souris. Les animaux observaient des congénères qui parcouraient un labyrinthe au bout duquel les attendait une récompense – l’objectif pour eux étant ensuite de suivre le même itinéraire afin d’obtenir de nouveau la même récompense. Les chercheurs ont alors constaté que des cellules particulières s’activaient dans l’hippocampe des chauves-souris observatrices, d’une façon qui dépendait de l’emplacement des autres volatiles.
Des régions spécifiques de l’hippocampe (en particulier, les zones appelées « CA1 » et « CA2 ») sont impliquées dans ce codage social. En effet, la stimulation ou l’inactivation artificielle de ces régions augmente ou diminue la capacité d’un animal à reconnaître les autres. Chez l’homme, les lésions de l’hippocampe épargnent souvent les souvenirs des visages, mais les patients ne parviennent plus à se remémorer le comportement des personnes associées. Cela suggère que cette région cérébrale n’enregistre pas simplement un visage ou d’autres détails personnels, mais relie plutôt diverses caractéristiques sociales.
Les deux dimensions d’une relation humaine
L’hippocampe analyse également les hiérarchies : les exigences d’un patron et d’un collègue, par exemple, sont évaluées différemment et rapportent des gratifications spécifiques. Des métaphores courantes illustrent les dimensions spatiales d’une hiérarchie : « gravir l’échelle sociale », parler à quelqu’un qui se trouve « au-dessus » ou « en dessous » de soi… Bien sûr, la hiérarchie n’est qu’un des éléments qui définissent une relation. La proximité sociale en est un autre, qui dépend notamment des liens familiaux, des objectifs communs du groupe et du souvenir des faveurs et des humiliations reçues. Pour décrire les relations humaines, il est alors possible de leur attribuer des coordonnées géométriques dans l’espace social, selon deux dimensions : la hiérarchie (ou le pouvoir) et l’affiliation.
Dans notre laboratoire, nous avons exploré ces idées au cours des dernières années. Nos résultats suggèrent que l’hippocampe organise l’espace social comme les autres types d’espace, c’est-à-dire sous forme de carte. Pour le montrer, nous avons proposé un jeu de rôle à des volontaires, qui devaient interagir avec des personnages fictifs pendant que leur cerveau était scanné.
Dans le jeu, les participants venaient d’emménager dans une nouvelle ville et cherchaient un emploi et un logement. Ils prenaient diverses décisions sur leur comportement envers les personnages qu’ils croisaient, lors de leurs interactions successives : leur demander d’accomplir quelque chose pour eux (ce qui montrait une forme de pouvoir), se soumettre à leurs demandes, faire ou non un geste d’attachement – comme une accolade…
À l’aide de ces décisions, nous avons associé à chaque personnage des coordonnées sur les dimensions du pouvoir et de l’affiliation, que nous avons matérialisées par un point sur une carte. Ces coordonnées variaient lors des différentes interactions et à chacune d’entre elles, nous tracions une ligne – un « vecteur social » – allant du participant au personnage. En procédant de la sorte, nous avons visualisé l’évolution des relations sous forme de trajectoires dans l’espace social et calculé les angles et les longueurs de ces vecteurs.
Nous avons ensuite analysé de façon croisée l’activité cérébrale des participants et les caractéristiques des vecteurs sociaux (angles et longueurs), afin de traquer les signaux neuronaux qui traitent ces informations. Il s’est avéré que l’activité de l’hippocampe permettait de reconstituer l’angle des vecteurs sociaux. L’hippocampe évaluait d’autant plus précisément les propriétés de ces vecteurs que le participant s’estimait doté de bonnes compétences sociales. Des résultats qui suggèrent que cette région cérébrale analyse les dynamiques sociales de la même façon que l’espace physique, c’est-à-dire en considérant des points dans un espace multidimensionnel et en évaluant les relations entre eux. Il est même possible que le système hippocampique-entorhinal soit sollicité chaque fois que nous classons des informations le long d’une dimension arbitraire, que ces informations soient physiques ou abstraites.
De nombreuses questions restent à préciser sur les cartes sociales du cerveau. Par exemple, comment le système hippocampique-entorhinal interagit-il avec les autres régions de l’encéphale ? Dans notre étude, nous avons découvert que le cortex cingulaire postérieur, une région également impliquée dans la représentation des informations spatiales, participe à la cartographie des relations : il analyse la longueur des vecteurs sociaux, mesurant ainsi la « distance sociale » qui nous sépare des autres.
Un lien entre cartographie et psychiatrie ?
À mesure que les recherches progressent, des questions d’ordre clinique se posent également : des processus de cartographie défectueux expliquent-ils certains troubles psychiatriques ? La découverte de cette architecture cérébrale aidera peut-être aussi l’intelligence artificielle à progresser : des modèles internes du monde bien organisés pourraient être la clé pour construire des machines plus intelligentes.
L’idée qu’un même système de cartographie sous-tende la navigation dans l’espace et dans le temps, ainsi que le raisonnement, la mémoire, l’imagination et la perception des dynamiques sociales, a une autre implication fascinante : elle suggère que notre capacité à construire des modèles du monde est ce qui nous rend si performants pour apprendre et pour nous adapter à notre environnement. Le monde est rempli de relations physiques et abstraites. Le plan des rues dans une ville et les cartes mentales de concepts interdépendants nous aident à lui donner un sens en extrayant, organisant et stockant des informations connexes. Il est facile de placer sur une carte spatiale existante un café qui s’installe dans une rue familière. De même, de nouveaux concepts peuvent être associés à des idées plus anciennes. Et une nouvelle rencontre est susceptible de remodeler notre espace social.
Grâce à ces cartes cognitives, nous sommes capables de simuler des choix possibles et de faire des prédictions en toute sécurité. Nous prenons aussi de multiples « raccourcis mentaux », en utilisant le même système cérébral qui nous indique un itinéraire alternatif lorsque nous sommes bloqués dans un embouteillage. Nous commençons tout juste à découvrir les propriétés et les capacités de ce système. Mais nous savons déjà que les cartes mentales font plus que nous aider à trouver des raccourcis dans l’espace physique : elles nous permettent de naviguer dans la vie elle-même.